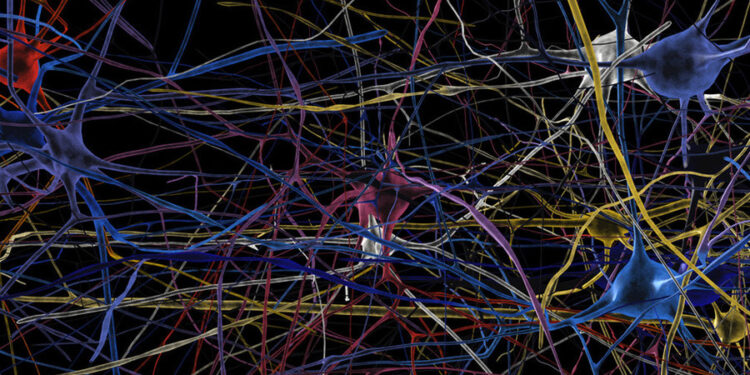![]()
Le consortium qui gère ce projet à un milliard d’euros et son principal bailleur, l’UE, ont signé un accord, après de profondes réformes issues d’une vaste polémique née en 2014
Le Human Brain Project (HBP), vaste projet européen d’étude et de modélisation du cerveau humain, peut aller de l’avant. Son consortium dirigeant et son principal bailleur de fonds, l’UE, qui doit assurer la moitié de son budget d’un milliard d’euros, ont signé vendredi un accord-cadre de partenariat (Framework Partnership Agreement, ou FPA). Une étape décisive, qui permet au projet, après une phase de lancement initiée en 2013, d’entrer dans une ère pleinement opérationnelle. Cet accord, surtout, clôt une polémique qui a ébranlé le HBP tant sur ses bases scientifiques qu’organisationnelles.
Celle-ci a débuté au printemps 2014: plus de 800 chercheurs signent une lettre à la Commission européenne, qui avait sélectionné le HBP en 2013, pour décrier ses visions scientifiques jugées irréalisables et dénoncer des abus d’autorité dans sa gouvernance; peu avant, le comité exécutif du HBP avait exclu du pot de financement de base assuré par l’UE la plupart des activités de neurosciences cognitives fondamentales. Suite à cette pétition, deux gremiums ont évalué la situation. Le premier – un comité d’experts européen – a proposé diverses réformes en février 2015. Le second groupe était constitué de 27 scientifiques, mobilisés par le médiateur allemand Wolfgang Marquardt, nommé en septembre 2014. Il a, dans les grandes lignes, abouti aux mêmes recommandations, qu’il a même détaillées et élargies. Toutes ces propositions de refonte du HBP ont été prises en compte dans le FPA; voici les quatre principales.
1•Infrastructures
Désormais, le développement des infrastructures du projet sera en son centre – l’un des buts principaux du HBP est de construire une infrastructure informatique pérenne pour la recherche sur les technologies de l’information et de la communication. Ceci de manière à fournir à la communauté scientifique des outils et services qui, couplés à des modèles mathématiques, permettront de mieux comprendre le cerveau et ses maladies. Est-ce à dire que l’ambition première du HBP – «simuler artificiellement le cerveau humain avec l’espoir de faire émerger une intelligence» – a été décalée, voire revue à la baisse? Selon les experts de la Commission, la volonté de générer une telle infrastructure était là dès le début du projet, bien que moins mise en avant. Or, sa nécessité s’est encore affirmée après l’analyse de la phase de lancement et des besoins exprimés par les scientifiques. «Nous avions recommandé de ne développer qu’un point d’attrait unique pour ce genre de vaste de projet européen», a rappelé Wolfgang Marquardt, satisfait.
2•Gouvernance
La structure de gouvernance a été revue, «pour assurer une plus de transparence, d’efficacité et de durabilité du projet, par le biais d’une claire séparation des pouvoirs entre les instances scientifique, administrative et exécutive». A cet égard, le directoire du HBP avait déjà pris les devants en mars 2015, dissolvant en janvier le triumvirat contesté qui formait le Comité exécutif (incluant Henry Markram, le charismatique initiateur du projet à l’EPFL). Philippe Gillet, vice-président de l’EPFL et président du directoire actuel du HBP, n’a toutefois pas donné les noms des personnes qui constitueront ces trois cénacles. «Ce changement va dans le bon sens, commente Alexandre Pouget, professeur de neurosciences à l’Université de Genève, qui fut l’un des instigateurs de la pétition. Reste à savoir, avant de se réjouir pleinement, qui va occuper ces différents postes.»
3•Entité européenne
La transition du HBP vers une entité légale européenne a été entérinée. Ceci afin d’améliorer le management et d’éviter qu’un rôle disproportionné ne soit dévolu à une seule université participante. En clair, le plan est de mettre sur pied une institution européenne apte à gérer un projet si vaste, qui ressemblerait à l’Agence spatiale européenne (ESA) ou au Laboratoire européen de biologie moléculaire (EMBL); une organisation dans laquelle plusieurs hautes écoles impliquées seraient représentées à un niveau équivalent. L’EPFL serait l’une d’elles, alors qu’elle était jusque-là considérée comme la «maison mère» du projet. Philippe Gillet assure pourtant qu’«un tel développement a figuré dès le début dans les discussions». Quant à la localisation des quartiers généraux de cette future institution européenne, rien n’a encore été décidé, dit le vice-président de l’EPFL.
4•Neurosciences cognitives de retour
Enfin – et c’était l’une des requêtes cruciales des pétitionnaires de 2014 –, des recherches en neurosciences cognitives seront réintroduites dans le HBP. Un appel à projets a déjà été lancé, qui a abouti à la sélection en septembre de quatre d’entre eux. «Ils porteront sur l’étude de la mémoire de travail, des mécanismes cérébraux de la vision, de la conscience et du sommeil», a expliqué l’une des responsables du HBP, Katrin Amuts, du Centre de recherches de Jülich. Et d’expliquer que «ces projets ont été choisis parce qu’ils permettront de nourrir les travaux de modélisation du cerveau». Pour Zach Mainen, du Champalimaud Neuroscience Programme et l’autre promoteur de la pétition, «c’est mieux que lorsque nous avons lancé notre action; toutes les neurosciences cognitives avaient alors été mises de côté. Mais c’est largement moins qu’à l’origine. On peut donc se demander si c’est vraiment une amélioration.» Ce segment des neurosciences cognitives ne sera, par contre, plus dirigé par Stanislas Dehaene, du Collège de France, l’un des meilleurs spécialistes mondiaux de ces questions. S’il se dit que ce professeur de psychologie cognitive expérimentale appuyait le mouvement frondeur de 2014, «Stanislas Dehaene a décidé de son plein gré de ne pas faire acte de candidature pour la suite» du HBP, dit l’un de ses responsable à l’EPFL, Sean Hill.
Au final, le médiateur Wolfgang Marquardt estime que la plupart de ses recommendations ont été suivies et que «cet accord est un pas en avant vers une structure scientifique meilleure et mieux balancée. Mais ce n’est pas la fin du développement du projet. Le défi du HBP est maintenant de regagner la confiance du public et des scientifiques par des efforts renouvelés.» Dans son rapport, le groupe qu’il y a dirigé a aussi émis certaines observations, dont certaines très critiques. L’une considérait par exemple comme non crédible les projets de simulations du cerveau, tels que proposés. Estime-t-il là avoir été entendu? «Nous n’avons jamais compris notre rôle comme celui de réviseur scientifique du projet, mais comme celui de médiateur. C’est pourquoi notre rapport contient ces deux catégories – recommendations et observations. Concernant les secondes, ce n’est pas à moi de me prononcer.» Alexandre Pouget souligne qu’«il est dificile d’evaluer si les simulations ont été modifiées dans la nouvelle mouture du HBP, un point pourtant essentiel étant donné les critiques émises par le comite de mediation».
Fort de ce feu vert de l’UE, le HBP, dont le budget final espéré est d’un milliard d’euros, peut donc entrer dans sa phase concrète, dans le cadre cette fois du programme Horizons2020. Une première période de deux ans sera soutenue à hauteur de 89 millions d’euros par l’UE, dont «10% seront accordés aux neurosciences cognitives», indique Katrin Amuts; elle débutera en avril 2016, après un appel à projets. Selon les experts, une deuxième tranche est déjà agendée pour 2018-2019, avec 88 millions à la clé. Chaque pays participants est appelé à alimenter le pot commun; à ce jour, la Suisse a prévu 80 millions de francs pour la période 2013-2017. Reste une dernière interrogation: l’issue de la crise liée aux accords bilatéraux entre la Suisse et l’Europe, remis en question par le vote du 9 février 2014. «Si aucun accord n’est trouvé d’ici à fin 2016, l’argent européen ne pourrait pas couler en Suisse», ont rappelé les experts européens. Ce qui vaudrait aussi pour les projets suisses inclus dans le HBP.