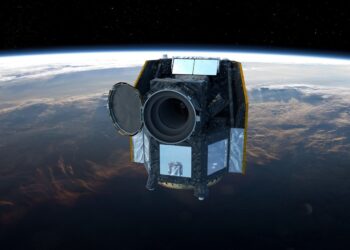![]()
L’expédition «Terra Submersa», dirigée par des archéologues de l’Université de Genève, tente de retrouver, sous les eaux d’une petite baie grecque, des vestiges du Néolithique qui pourraient bouleverser l’histoire du Vieux continent
Le soleil cogne sur la baie de Kiladha, non loin de Nauplie, dans le Péloponnèse. Depuis le pont du PlanetSolar , les flots calmes incitent plus à la baignade qu’à fixer un écran d’ordinateur. Pourtant, Julien Beck, archéologue de l’Université de Genève, n’en décolle pas, ébahi. «Vous voyez ce trait noir, c’est peut-être ce que nous cherchons!» «Je n’ose pas encore appeler cela une «couche culturelle», dit en souriant Dimitris Sakellariou, géologue au Centre hellénique de recherche maritime. Les deux scientifiques, piaffant devant les données fournies par leur «torpille» d’échosondage baladée en mer, font partie de l’expédition Terra Submersa . Et l’objet de leur quête, dont ils estiment entrapercevoir des signes, là, sous quelques mètres d’une eau claire et une couche de vase, n’est rien de moins que le plus ancien village d’Europe, vieux de plus de 8000 ans au moins. «C’est très excitant», dit Julien Beck.
Cette aventure archéologique démarre en 1955, par une partie de pêche. Des adolescents du coin débarquent sur une plage voisine de Kiladha, au pied d’une grotte utilisée comme abri par les bergers, pour y griller leurs poissons. «En creusant pour faire notre foyer, nous sommes tombés sur des fragments de poteries», raconte l’un d’eux, Adonis Kyrou, âgé aujourd’hui de 76 ans, et toujours aussi fier de sa découverte:
«Nous les avons montrés au Service archéologique grec, qui nous a dit de ne plus toucher à rien.» Quelques années plus tard, des archéologues des Universités américaines de Pennsylvanie et d’Indiana font un sondage dans la grotte, nommée Franchthi. Vite, il apparaît qu’elle regorge de vestiges préhistoriques. Pour avoir retrouvé à 10 mètres sous terre les cendres d’une ancienne éruption volcanique bien identifiée, la couche en question a pu être datée à 37 500 ans av. J.-C. «De ce point de départ, les fouilles, telle une capsule temporelle, ont permis de reconstituer l’utilisation du site avec des détails inouïs», dit Julien Beck.
Au paléolithique supérieur, qui s’étend en Grèce entre –40 000 et –10 000, la grotte était un lieu de résidence passagère pour les chasseurs-cueilleurs. Les objets retrouvés correspondant à cette époque incluent des ossements (ânes sauvages, perdrix, cerfs), des restes de poissons ou des graines carbonisées (poiriers, lentilles, etc.). Parfois, il est même possible de préciser à quelle saison la caverne a été occupée, en observant les cercles de croissance des escargots consommés alors.
Durant le mésolithique grec (–10 000 à –7 000), après deux gros millénaires durant lesquels la grotte est abandonnée à cause du froid, elle est à nouveau utilisée, mais sporadiquement et comme lieu de sépulture ou de fête. «La grande rupture survient au néolithique (–7000 à –3000) avec l’apparition de la sédentarité, reprend Julien Beck. C’est un changement spectaculaire dans la destinée humaine: en créant des villages, en cultivant des champs, en élevant des bêtes, en générant des surplus et en planifiant, se fonde un type d’économie qui a perduré jusqu’au XVIIIe siècle et la révolution industrielle.» Les archéologues savent que la grotte ne servait alors pas de lieu d’habitation, quand bien même ils y ont trouvé des vestiges du néolithique, dont moult éléments de parure. «Dès lors, il y a tout lieu de penser que les Homo sapiens ont pu installer, il y a 9000 ans, leur village entre la caverne et la rivière en contrebas, tant cet endroit était un coin de paradis.»
De cette rivière, il ne reste aucune trace visible, la mer recouvrant aujourd’hui la zone car étant 120 m plus haut qu’il y a 20 000 ans, lors de la dernière glaciation. «Mais c’est là que le projet devient passionnant, car il mêle géologues et archéologues», dit Julien Beck. Alors que les seconds s’attachent aux signes laissés par les hommes du passé, les premiers reconstruisent ce qu’ils appellent des «paysages préhistoriques submergés»: «Nous tentons de décrire l’environnement dans lesquels les hommes évoluaient.»
Pour y parvenir, les géophysiciens procèdent notamment par carottage, afin de «lire» dans les couches sédimentaires. Une autre méthode consiste à utiliser des échosondeurs: «Ces instruments envoient des ondes vers le fond de la mer, et mesurent leur réflexion dans les strates géologiques successives, explique Dimitris Sakellariou. Or cette réflexion est différente selon la composition de chaque couche.» Pour opérer, l’équipe dispose d’appareils émettant ces ondes, en forme de tubes, qu’ils ont pu traîner derrière deux navires, le grec Alkyon ainsi que le suisse PlanetSolar. «L’avantage de ce navire solaire est qu’il est facilement dirigeable, et permet un quadrillage de la baie avec une précision fine», dit son capitaine, Gérard d’Aboville.
Et déjà, les premiers résultats parlent. Les scientifiques ont pu reconstituer diverses «paléo-plages», témoins du niveau des océans qui a varié en fonction des glaciations. «Il y a 140 000 ans, l’île d’Ipsilis, à l’entrée de la baie, était reliée au continent par un isthme couvert de dunes de sable, dont l’orientation indique l’origine géographique des vents dominants de l’époque», s’enthousiasme Julien Beck. C’est aussi grâce à ces échosondages que les géophysiciens ont pu repérer, dans les couches sédimentaires, la forme de gouttière en U caractéristique du lit d’un fleuve qui formait un coude devant la grotte. Et c’est, surtout, dans ces données qu’ils ont débusqué une couche s’arrêtant brusquement – ce qui est très inhabituel. «De cette zone vaste de 500 m2, on pense qu’il peut s’agir des restes d’un village», dit Dimitris Sakellariou.
Cette découverte conforterait une hypothèse susceptible de chambouler l’histoire. «Les archéologues ont toujours admis que le mode de vie sédentaire du néolithique est né au Proche-Orient, puis s’est répandu par voie terrestre en Europe, par l’Anatolie, décrit Julien Beck. Or une étude publiée en décembre 2013 dans la revue Antiquity et utilisant la méthode de datation au carbone 14, a conclu que les vestiges néolithiques mis au jour à Franchthi étaient plus anciens que ceux découverts au nord-est de la Grèce, où l’on s’attendait à retrouver les traces les plus préhistoriques de cette époque, puisque les peuples auraient dû transiter par là avant de venir dans le Péloponnèse.»
Comment expliquer cette contradiction? «Peut-être a-t-on négligé l’aventure maritime. Peut-être que la navigation existait bel et bien depuis très longtemps»; les hommes auraient pu naviguer il y a plus de 100 000 ans déjà, selon d’autres études. Si donc ceux du néolithique sont arrivés à Franchthi par la mer, ce village pourrait être le plus vieux du pays, et donc de toute l’Europe!
Sur la base de ces théories, des trouvailles archéologiques, et surtout des mesures géophysiques, l’équipe de Julien Beck a lancé, la semaine passée, des fouilles sous-marines, qui vont durer plusieurs années. Et s’annoncent ardues, dit Despina Koutsoumba, du Service grec des antiquités sous-marines, qui participe au projet: «La couche de vase de plusieurs mètres a l’avantage de bien conserver les vestiges. Mais creuser dans la boue représente toujours un défi.» L’archéologue se réjouit de la collaboration avec l’équipe suisse, car «vous les Suisses avez une grande expérience des fouilles dans ce type d’environnement, qui ressemble à un lac». La Suisse jouit en effet d’un savoir-faire hors pair, résultant de plus de cent cinquante ans d’études des sites palafittiques.
Du côté de l’Ecole suisse d’archéologie en Grèce, aussi partie prenante de l’aventure, au même titre que le Laténium de Neuchâtel, on se «réjouit d’ouvrir un nouveau pan de recherches», dit Karl Reber, son directeur. Depuis cinquante ans en effet, les fouilles suisses visant la période classique se sont concentrées à Erétrie, avec d’immenses succès à la clé. «De plus, ce projet servira de vitrine pour populariser l’archéologie et attirer de nouveaux sponsors.»
A l’heure où les plongeurs suisses et grecs s’impatientent de faire vrombir leur aspirateur subaquatique, Despina Koutsoumba tempère l’enthousiasme: «En archéologie, on apprend tôt que toute hypothèse semblant logique ne reflète pas forcément la réalité. Par ailleurs, au fil des siècles, si la mer a grignoté la côte petit à petit, le village néolithique potentiel délaissé par ses habitants peut avoir été fortement endommagé par cette lente montée des eaux. Pour avoir un site bien riche et bien préservé, il faudrait idéalement qu’un événement cataclysmique, tel un tremblement de terre, l’ait englouti brusquement. Je ne doute donc pas qu’on trouve des vestiges. Les fondations indiscutables d’un village? J’en doute un peu. Mais Julien, lui, y croit fort.»
Tout en ne niant pas l’argument de sa collègue grecque, l’intéressé ne dit pas le contraire: «Selon Dimitris Sakellariou, la structure que l’on voit dans les échosondages ne s’explique pas par quelque chose de naturel. C’est la plus belle découverte de l’expédition jusque-là. Et celle-ci ne fait que commencer!»
[Download not found]