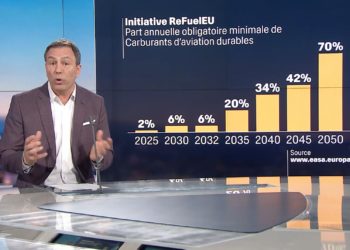Des tests qui permettraient de dépister le cancer dans le sang plusieurs années avant son apparition : depuis quelques mois fleurissent les annonces sur ce qui pourrait, un jour, constituer une avancée majeure contre la maladie. Une percée qui vient aussi avec son lot d’inconvénients, car encore faut-il savoir quoi faire après l’annonce d’un possible dépistage positif.
Cette méthode se base sur une découverte datant de 1948 déjà : dans le corps humain, toute cellule qui meurt relâche dans le sang des fragments d’ADN qu’elle contient en son noyau. Et cela vaut aussi pour les cellules cancéreuses, dont le matériel génétique se met ainsi à circuler dans le plasma sanguin.
Depuis quelques années, avec les avancées spectaculaires des technologies de captage et de séquençage du matériel génétique, on sait comment identifier précisément cet ADN dit « circulant ». De quoi ouvrir des perspectives fascinantes, comme dans cette étude de chercheurs américains publiée en mai 2025 dans la revue Cancer Discovery, et qui prétend démontrer qu’« il est possible de détecter de l’ADN circulant de tumeur plus de trois ans avec le diagnostic clinique !» Avec, au final, l’augmentation des chances de guérison.
Aux Etats-Unis, au moins un test, nommé Galleri®, est déjà commercialisé. La promesse de cette analyse ? Repérer dans le sang de la personne qui la commande plus de 50 types de cancer différents, en indiquant leur origine autant que faire se peut. Selon Grail, la société qui le vend, ce test, évalué sur plus de 50’000 participants à une étude, aurait affiché des résultats concluants. Bien qu’il n’ait pas encore été formellement validé par l’autorité américaine des médicaments (FDA), cet outil de dépistage est déjà à vente aux particuliers qui le souhaitent, tant l’intervention est facile, peu invasive et donc acceptable : une simple prise de sang.
Dépistage aussi parfois problématique
Pour Petros Tsantoulis, médecin adjoint agrégé en oncologie de précision aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), tout ce qui permet d’accélérer le diagnostic d’un cancer est, a priori, positif. « Mais le dépistage très précoce, alors que les tumeurs sont encore si petites qu’elles sont invisibles, peut aussi être problématique, indique le médecin. Il faut en effet que le cancer soit détectable par les moyens à disposition, par exemple par les examens radiologiques. Sinon, on ne peut pas agir. Donc un résultat d’un test de dépistage qui est positif mais qui ne permet pas d’orienter la prise en charge clinique conduit à une anxiété chez le patient, mais pas finalement à un traitement efficace. Donc il faut faire attention à cela : il faut pouvoir détecter le cancer à un stade où on est capable de le traiter. » Ce d’autant plus que, si un patient est porteur de quelques cellules cancéreuses ayant justement relâché de l’ADN dans son sang – un ADN qui pourrait donc être détecté –, il se peut dans certaines situations que ces tumeurs ne se développent jamais, et restent dormantes, ne faisant aucun mal patient. Dans ce cas, ne pas s’en savoir porteur est évidemment moins angoissant.
Mais ce destin de l’embryon de tumeur, dormant ou non, reste difficile à prédire. Pour Samia Hurst, directrice, de l’Institut Ethique Histoire Humanités à l’Université de Genève (UNIGE), les implications sont donc plus larges devant l’annonce de la présence d’un cancer même à un stade extrêmement précoce : « Même si cliniquement on ne peut rien faire, il y a des personnes qui voudront réorganiser leur vie pour les mois suivant s’ils savent qu’il y a une forte probabilité qu’après, dans les 6 à 18 mois, on va leur diagnostiquer un cancer. »
Pour elle – comme pour le médecin –, pouvoir détecter précocement le cancer reste un pas significatif. Mais la question la plus importante est ailleurs : « Une des choses qu’il va s’agir de démontrer, c’est que sur la base d’un tel dépistage, on est capable de diminuer la mortalité associée à la maladie. Et pas seulement de prolonger le temps avec lequel on vit avec la maladie, puisqu’évidemment, en diagnostiquant plus tôt, on aura déjà fait ça. Même si par la suite il n’y avait aucun changement possible», résume Samia Hurst.
Vastes études de validation
De vastes études sont en cours pour attester de cette baisse de mortalité pour tel ou tel cancer au sein d’une population en générale. De quoi alors potentiellement déployer massivement ces tests parmi les médecins et les patients. Mais de telles études sont complexes à mener, notamment parce qu’elles impliquent de grandes cohortes, et prendront encore des années.
Pour autant, ces avancées en analyse biomoléculaire pourraient déjà être bientôt utiles, dans d’autres cas précis, comme le relève Petros Tsantoulis : « Des technologies similaires de l’ADN tumoral dans le sang pourraient avoir une application plutôt pour le suivi de patients qui ont eu un cancer, qui ont été traités à but curatif et qui pourraient éventuellement avoir une récidive. Une détection précoce de cette récidive pourrait nous aider à les gérer de manière plus efficace. » Et lors de récidive, on sait à quel point chaque mois gagné est extrêmement précieux.
Selon l’oncologue genevois, une telle application pourrait être mise en place d’ici peu en Suisse.
>> L’analyse en plateau de la professeure Solange Peters, cheffe du Service d’oncologie médicale du CHUV.