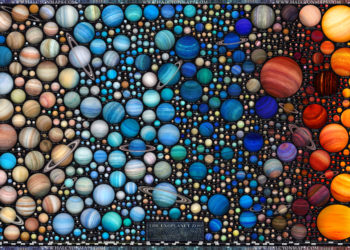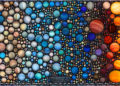Les physiciens pensent déjà à l’ère post-LHC: un gigantesque accélérateur de 100 km de circonférence, qui pourrait se faire soit au CERN soit en Chine dès 2020. Une conférence se tient à Genève pour lancer les études
L’accélérateur LHC, au CERN à Meyrin, qualifié de «plus fantastique machine à découvertes de tous les temps», a permis une première trouvaille de taille: celle, à l’été 2012, du boson de Higgs, tant traqué par des hordes de physiciens des particules du monde entier. Et voilà que ceux-ci, alors que le LHC doit être exploité deux décennies encore, pensent déjà à l’étape suivante, un anneau de 100 km de circonférence, quatre fois plus long que le LHC. Ils doivent tous se rencontrer du 12 au 15 février à Genève pour lancer les discussions sur les études de cet accélérateur géant. Et par là, aussi, une course entre l’Europe et la Chine, puisque c’est dans l’une de ces deux régions que ce projet pharaonique devrait se concrétiser, les Etats-Unis jouant le rôle d’arbitre influent.
Pourquoi toujours plus grand? Parce que, pour l’heure, le LHC a bien mis au jour le boson de Higgs, mais uniquement lui, et rien d’autre. Aucune piste vers une autre physique. Ni de signe de particules exotiques permettant d’aller au-delà du Modèle standard, la fiche de construction de l’Univers établie par les physiciens, édifice théorique dont ce boson constituait la brique manquante, mais qui connaît malgré tout encore des lézardes.
Justement, «nous modifions le LHC pour, dès janvier 2015, l’utiliser à son énergie prévue (14 TeV), contre la moitié aujourd’hui, dit Frédérick Bordry, le directeur des accélérateurs du CERN. Exploiter cette machine à ses pleines capacités est la première priorité fixée par le Conseil du CERN en 2013.» Son plan contient ensuite une deuxième phase d’amélioration, dès mi-2018, puis une troisième vers 2023, avec à chaque fois l’idée de décupler la «luminosité», à savoir le nombre de collisions entre particules circulant dans l’accélérateur, enfoui à 100 m sous terre. Et Frédérick Bordry d’espérer: «Nous apercevrons peut-être des traces de particules «supersymétriques», jamais observées mais découlant d’une théorie plus vaste que le Modèle standard, ou alors des bribes de matière sombre», cette entité qui constitue un quart de l’Univers mais dont la nature reste inconnue.
En parallèle, les instances du CERN suivent de près les développements d’un engin complémentaire aux machines circulaires: un accélérateur linéaire. Il existe un tel projet au Japon, baptisé International Linear Collider (ILC), et un autre au CERN, nommé CLIC, d’une technologie un peu différente. Ne pouvant jouer sur tous les tableaux, l’Europe se verrait bien soutenir l’initiative du Japon si son gouvernement, qui voit là une possibilité de relance du pays après l’accident de Fukushima, se décide. L’avantage de ces accélérateurs linéaires, qui font aussi se télescoper frontalement des particules, est de pouvoir faire des mesures d’une grande précision sur ces dernières. Mais, pour grattouiller et surtout étudier cette physique inédite dont rêvent les savants, il faudra bien davantage…
«Partant de là, nous avons regardé ce que nous pouvions faire au LHC, dans le tunnel existant de 27 km, dit Frédérick Bordry. En doublant le champ magnétique des aimants impliqués – ce qu’on estime réaliste d’ici à 20 ans –, on pourrait doubler l’énergie de collision. Mais ce sont de gros investissements. Justifiés pour un pas si ténu? Pas sûr… C’est pourquoi le Conseil du CERN a estimé – c’est sa deuxième priorité – qu’il fallait viser un horizon plus lointain.» Et plus ambitieux.
C’est ainsi que l’idée d’un accélérateur de 100 km, aussi à cheval sur la frontière franco-suisse et entourant le Salève, s’est affirmée. Et là, l’énergie atteinte serait de 100 TeV, soit sept fois plus qu’aujourd’hui, les particules pouvant être accélérées plus efficacement sur un vaste anneau que sur un petit. «Nous sommes au début des discussions, tempère Frédérick Bordry. L’idée est d’avoir un document de présentation aussi abouti que possible en 2018, lorsque la stratégie du CERN sera réévaluée. Cela permettrait un début du chantier en 2020, et un lancement en 2035», lorsque le LHC fermera ses robinets de particules. «Mais, pour disposer d’une machine dans plus de 20 ans, il faut planter les graines maintenant…»
Le directeur des accélérateurs du CERN sait que l’heure n’est pas à la tergiversation. La Chine est aussi sur les rangs. Une telle machine lui permettrait d’occuper les devants de la scène en physique, de la même manière que le pays l’a fait dans le domaine spatial, devenant récemment la troisième puissance à se poser sur la Lune. La semaine prochaine à Genève, Yifang Wang, directeur général de l’Institut de physique des hautes énergies (IHEP) de Pékin, viendra présenter le plan chinois: «Nous avons une tradition de recherche dans le domaine des petits collisionneurs électrons-positrons [le pendant de l’électron, de charge positive]. Notre idée est de construire, dès 2020 près de Pékin, un tunnel circulaire de 50 à 70 km pour un tel accélérateur, qui servirait d’«usine à Higgs», tant il produirait ces particules en grand nombre, ce qui permettrait de les étudier. Après cinq ans, on ôtera cette machine et on la remplacera par un accélérateur à protons, tel le LHC, pour monter, vers l’an 2036, à des énergies de 50 à 70 TeV.» Un peu moins qu’au CERN? «Nous devons rester réalistes, aussi financièrement.» Selon lui, le coût de chacune des deux phases serait évalué à quelque 3 milliards de francs suisses.
Rolf Heuer, directeur général du CERN, prend note, mais insiste sur les atouts de son institution: «Outre un personnel scientifique et technique très qualifié, il existe ici une infrastructure de recherche. L’on ne peut pas construire un accélérateur géant sans en avoir d’autres, plus petits, pour lancer le faisceau. Bien sûr, la Chine peut décider de se lancer seule, mais cela lui sera très difficile sans l’appui de toute notre communauté.» Yifang Wang l’admet: «Nous devrions tout construire et apprendre dans ce domaine. Nous tablons sur des soutiens internationaux, aussi financiers. En fait, nous espérons que tous les acteurs travailleront ensemble. Aussi, je ne peux affirmer avec certitude qu’une telle machine se fera en Chine.» Cela dit, le directeur de l’IHEP pense avoir une carte maîtresse à jouer: «Il y a fort à croire que le gouvernement sera intéressé à soutenir ce projet à travers les énormes investissements dans la science générés par la forte croissance en Chine.»
Au milieu de ce match sino-européen, un tiers acteur: les Etats-Unis. «Nombre de nos scientifiques souhaitent que nous menions à nouveau la danse en physique des particules», confie Stuart Henderson, directeur des accélérateurs au Fermilab, près de Chicago. Et si l’un ou l’autre projet américain de Very Large Hadron Collider, aussi avec un accélérateur de 100 km, ont été présentés récemment, le physicien ne croit pas qu’ils pourront mûrir, à cause de la situation budgétaire difficile; l’abandon du Superconducting SuperCollider au Texas, un projet d’accélérateur de 87 km dont 23 km de tunnel avaient déjà été creusés, décidé en 1993 par le Congrès, est resté en travers de bien des gorges de physiciens américains.
Mais, pour Stuart Henderson, il est indubitable qu’«un tel futur projet devra être global, vraiment international». Car le responsable entrevoit déjà le rôle crucial des Etats-Unis: «Nous sommes en pointe sur la technologie des aimants révolutionnaires (en niobium-étain) qui équiperaient cet accélérateur. Nous les développons depuis quinze ans.»
Pour l’heure, les Etats-Unis ne s’avancent pas davantage. «La stratégie américaine dans ce domaine est en train d’être finalisée; elle sera présentée en mai. Une chose est sûre: elle contiendra deux objectifs, l’exploitation complète du LHC au CERN auquel nous collaborons, et le développement d’activités dans la recherche sur les neutrinos.»
Il est un point sur lequel la majorité des participants à la réunion de Genève sont déjà d’accord: «Pour que la construction de la future machine soit soutenue par les décideurs, dit Rolf Heuer, elle doit être motivée par un défi scientifique clair», tout comme la traque du boson de Higgs était la raison d’être du LHC. Et tous espèrent que ce dernier permettra sous peu d’entrouvrir des portes vers cette physique inédite.
«D’un autre côté, on pourrait ne pas avoir besoin de ces résultats pour justifier un nouvel accélérateur, ose Yifang Wang. Le savoir actuel, et les lacunes qu’il contient, devrait suffire comme raison.» Mieux: «Même si l’on construit une machine et ne trouve absolument rien, ce serait l’issue la plus fascinante de toutes», rêve Nima Arkani-Hamed, de l’Institute for Advanced Studies de Princeton, dans un blog du Scientific American, tant cela laisserait les savants cois devant autant de mystères concernant l’Univers.