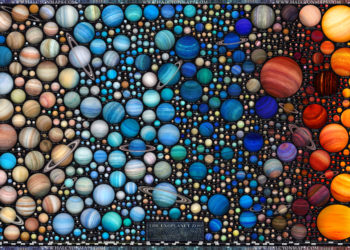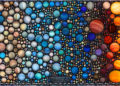La dose de rayonnements moyenne reçue par habitant pour les diagnostics a bondi de 20% en dix ans. L’OFSP veut auditer les principaux centres de radiologie du pays
Tout voir dans le corps. En 3D. Et dans les moindres détails. Pour diagnostiquer un cancer ou d’autres affections. C’est ce que permettent les outils d’imagerie médicale, tels les scanners (CT-Scan ou tomodensitométrie, en mots savants). Afin d’obtenir ces images, ces appareils exposent les organes à des rayonnements X. Au point parfois d’induire… des cancers (1 à 2% des cas, selon une étude parue dans le New England Journal of Medicine). Des cancers qui devront être repérés à l’aide des mêmes méthodes de radiologie, puis traités par radiothérapie… «C’est ce cercle vicieux que nous visons à briser, en introduisant des audits cliniques des centres de radiologie importants en Suisse», dit Carine Galli Marxer, de l’Office fédéral de la santé publique. Le projet est décrit dans le bulletin de l’office publié lundi.
«Un gros travail a déjà été fait pour optimiser et limiter les doses de rayonnement ionisant appliquées, admet la responsable. Nous devons maintenant Å“uvrer pour nous assurer que tout examen est vraiment justifié. Le but est d’améliorer constamment la qualité des soins et minimiser les effets collatéraux négatifs.»
Se soumettre à une radiographie ou un scanner n’est en effet pas innocent, le corps recevant une certaine dose d’irradiations. Celle-ci se mesure en millième de Sievert (mSv). Il faut savoir que notre environnement naturel (les roches, le gaz radioactif radon qui en émane) soumet inévitablement l’homme à une dose annuelle moyenne de 3 mSv. Voler en avion durant cinq heures, et c’est 0.04 mSv que l’on reçoit, à travers cette fois le rayonnement cosmique à haute altitude; c’est d’ailleurs l’équivalent d’une radio du thorax. Un scanner de cette zone de l’organisme l’expose cependant à une dose de 6 mSv! La raison: l’engin réalise en fait des centaines de radios à rayons X en tournant autour du patient.
Ces rayonnements ionisants interagissent avec le corps: des modifications génétiques ou un cancer peuvent survenir des années plus tard. Après Hiroshima et Nagasaki, l’augmentation du risque de mortalité a été estimé à 5% par Sievert reçu – une dose d’irradiation énorme donc. «L’extrapolation de ce taux aux basses doses d’exposition reste controversée», dit Laurent Poncioni, radiologue à la Clinique Cecil à Lausanne. «Ce qui est sûr, c’est que les jeunes sont plus sensibles que les personnes âgées», précise Carine Galli Marxer.
Une étude du CHUV a néanmoins montré en 2008 qu’en dix ans, la dose moyenne reçue par habitant lors des diagnostics avait bondi de 20%, passant de 1 à 1,2 mSv. Les examens par CT-Scan y contribuent désormais à plus de 68%. «C’est vrai, on fait davantage de scanners», dit Stefan Duewell, président de la Société suisse de radiologie (SSR). Pour plusieurs raisons: «Pour les médecins, l’examen est rapide et précis.» «Cela correspond à la pratique actuelle de vouloir visualiser l’endroit du corps où opérer», dit Laurent Poncioni, qui propose d’introduire une «carte de suivi du patient», indiquant les doses déjà reçues durant sa vie. De leur côté, «ces patients sont informés par les médias des possibilités de ces techniques, dit Stefan Duewell, et les demandent à leur médecin», souvent pour se rassurer. «Ils estiment même, parce qu’ils payent cher leur assurance de soins, y avoir droit!»
Selon Carine Galli Marxer, il faut dès lors se demander si tous ces examens sont justifiés: «En Suède, une enquête a montré que 20% des CT-Scan ne l’étaient pas.» «En Suisse, il y a une claire prise de conscience, rétorque Laurent Poncioni. Nous sommes formés à cela.» «Je ne suis pas sûr qu’il y ait beaucoup d’examens injustifiés», abonde Stefan Duewell.
Une des explications serait-elle alors à chercher du côté de l’offre? «De plus en plus d’institutions hospitalières s’équipent de scanners; il y en a plus de 250 en Suisse», dit Carine Galli Marxer. Est-ce à dire que cette activité est particulièrement rentable? «Les cliniques privées ont un but lucratif, admet Laurent Poncioni. Cela dit, avec l’introduction du système Tarmed en 2004, le remboursement pour un examen par scanner est 30% moins élevé qu’avant. Les institutions hospitalières doivent certes s’équiper d’instruments les plus perfectionnés», sous peine de voir les patients aller ailleurs. «Mais c’est probablement plus pour répondre à une demande que pour «faire de l’argent» que ces machines sont installées.»
Or «ces examens sont toujours demandés par des médecins traitants, pas commandés par les radiologues eux-mêmes», souligne Stefan Duewell. Des praticiens chez qui les lacunes concernant ce domaine en pleine évolution sont latentes, estime Carine Galli Marxer. Une étude menée en 2007 par l’Université de Bochum a ainsi montré que 72% des médecins non-radiologues sous-estimaient largement les doses induites lors d’un CT-Scan.
«Si le scanner ne semble pas nécessaire, nous proposons des examens de substitutions sans rayons ionisants, comme l’IRM ou les ultrasons», assure Stefan Duewell. Mais d’admettre: «Il s’agit d’améliorer la communication entre généralistes, qui prescrivent ces examens, et radiologues.» «Ce d’autant qu’avec une population vieillissante, la demande ne va pas baisser», dit Laurent Poncioni.
«C’est justement l’objectif des audits cliniques, que nous souhaitons lancer dès 2017», dit la responsable de l’OFSP, en précisant que l’idée même de cette démarche a été inscrite en 1997 déjà dans la législation européenne.
Concrètement? «Jusque-là, seuls avaient lieu des contrôles des installations effectués par des techniciens. L’idée sera de faire faire à des médecins indépendants des évaluations systématiques et continues de toutes les procédures de soins, selon des standards: de la dose à appliquer jusqu’à la position du patient dans l’appareil, en passant par un protocole de la communication entre toutes les personnes du corps médical. Mais il ne s’agit pas d’une inspection.» Et d’ajouter que, après une étude pilote pour laquelle dix centres suisses ont ainsi été sensibilisés, ces derniers avaient pu noter une baisse de 30% de la dose moyenne par patient pour certains examens.
L’OFSP se base aussi, dans sa réflexion, sur l’expérience finlandaise: tous les centres de radiologie y ont déjà été audités deux fois en dix ans. Résultat? «Une meilleure discussion entre professionnels de la santé sur la qualité des soins et les pratiques de référence, et une baisse de la dose moyenne, résume Hannu Järvinen, de l’Autorité de sécurité nucléaire et radiative (STUK). De plus, on peut dire, sans pouvoir le quantifier, que les coûts de la santé liés à ce domaine ont diminué, en raison des examens superflus non réalisés.» «C’est aussi un objectif que nous visons à long terme», dit Carine Galli Marxer, en ajoutant que, en comparaison européenne, «la Suisse n’est ni en retard ni en avance». Au fait qui va supporter les coûts de ces audits? «Les établissements de soins concernés, mais pour couvrir uniquement les coûts effectifs, de l’ordre de quelques milliers de francs», répond-elle, en admettant que cela pourrait créer initialement des réticences.
Laurent Poncioni, lui, estime que «les radiologues optimisent leur travail parce qu’ils lisent la littérature scientifique, pas parce qu’ils sont audités». Stefan Duewell ne «souhaite pas juger de l’utilité de tels audits avant d’en connaître le contenu précis». «Les objectifs de cette démarche sont encore mal compris, dit Carine Galli Marxer. Ce que nous voulons, c’est mettre sur pied une culture de la qualité pointue en radiologie». A cette vision, le président de la SSR «souscrit complètement».