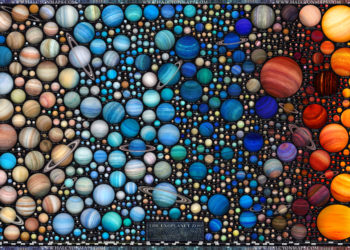![]()
En vue des futurs longs voyages spatiaux, les scientifiques développent des «écosystèmes clos artificiels», avec des technologies de recyclage qui seront peut-être d’abord très utiles sur une Terre en mal de durabilité
«A bord de la Station spatiale internationale (ISS), réparer le système de purification du CO2 prend deux ou trois jours. A l’avenir, il faudra que cet instrument soit plus robuste. Ou plus simple à rafistoler…» Présente à Lausanne jeudi, l’astronaute italienne Samantha Cristoforetti est venue narrer son séjour à bord de ce que les spécialistes appellent un «écosystème clos artificiel» – le sujet d’un double colloque organisé par l’Agence spatiale européenne (ESA). Et le recyclage du dioxyde de carbone n’était qu’un des aspects. Car pour un voyage spatial, long de plusieurs mois, voire une implantation sur un autre astre, il s’agira autant de tout recycler (air, eaux, déchets) que de produire de la nourriture in situ; impossible d’emporter à bord tous les éléments nécessaires à la survie, dont la masse serait considérable, et donc extrêmement coûteuse à lancer.
Quelque 140 experts se sont réunis à l’Université de Lausanne (UNIL), avec parmi eux, deux des fondateurs de Biosphere2, l’immense écosystème clos construit en 1991 déjà aux Etats-Unis. Tous sont venus pour évoquer ce futur de la conquête de l’espace. Mais aussi pour évaluer dans quelle mesure ces technologies durables peuvent déjà être utiles sur la Terre.
L’ESA se penche sur ces questions depuis vingt-sept ans, à travers le projet Melissa, basé à l’Université autonome de Barcelone (UAB). «Il s’agit d’une installation de démonstration consistant en cinq compartiments», explique Christophe Lasseur, l’un de ses responsables.
En résumé, l’un des modules contient des rats. Un autre sert à transformer en oxygène le CO2 qu’ils expirent, à l’aide d’algues. Lesquelles sont «nourries» avec des nutriments issus du recyclage, dans d’autres compartiments, des déjections des rongeurs ou des végétaux qu’ils consomment, eux aussi produits au sein de cette «boucle fermée». Mais l’on n’en est pas encore là: en 2015, seul le module des rats a été connecté avec celui des micro-algues. «Cette première étape fonctionne très bien, assure Christophe Lasseur. Nous avons démontré que les modèles de fonctionnement de ces systèmes que nous décrivons et contrôlons à l’aide de formules et d’équations sont génériques, autrement dit qu’ils pourront être transposés dans d’autres expériences similaires.»
Projet suisse sur l’ISS
Le pendant en orbite de cette expérience est d’ailleurs planifié. Au sein du projet ArtEMISS, l’entreprise belge QinetiQ a développé un petit photobioréacteur pour étudier comment les micro-algues croissent dans l’espace. Et avec cette société, Ruag Space, à Nyon, planche déjà sur la suite, un environnement clos nommé BIORAT1, qui sera installé sur l’ISS. A l’intérieur, trois souris – et non plus des rats, tout devant être miniaturisé dans l’espace – respireront l’oxygène généré sous forme de bulles par ces algues. «Mais si sur Terre, les bulles d’oxygène remontent à la surface du liquide de culture des algues et peuvent être séparées facilement, ce n’est pas le cas en apesanteur, détaille le responsable, Samuel Gass. Nous recourons donc à des membranes particulières pour gérer les échanges de gaz (CO2 et oxygène) avec l’espace habité par les souris.» Si tout va bien, ce bioréacteur à plusieurs millions de francs, et qui serait à terme plus efficace que les systèmes complexes de traitement de l’air en boucle ouverte équipant l’ISS, devrait y être installé pour trois mois dès 2020.
Dans Melissa, la prochaine étape est d’adjoindre à la première boucle un troisième compartiment: «De l’urine, celui-ci va extraire des nitrates, soit de l’engrais pour les algues, par un processus bactérien appelé nitrification», dit Christophe Lasseur. Mais transformer l’urine en eau potable tout en en extrayant les nutriments n’est pas une simple affaire, est venu rappeler Kai Udert, de l’institut Eawag à Dübendorf, qui développe, lui, des toilettes pour les pays pauvres: «Une bonne nitrification dépend du pH du liquide. Or ce pH varie en fonction de l’urée (un des composés de l’urine), qui s’évapore rapidement. Il s’agit donc de bien gérer les apports d’urine fraîche.»
Tout cela sans même encore évoquer la récupération et le traitement des déchets solides; à ce titre, en août 2015, les occupants de l’ISS ont pu déguster les premières laitues cultivées à bord. «Pour l’instant, ces mécanismes de recyclage, qui se font à l’aide de bactéries, correspondent à une «boîte noire», dit Vimac Nolla-Ardèvol, de l’Université de Louvain: on sait ce qui entre et ce qui sort, mais pas ce qui se passe entre deux. Notre objectif est de caractériser dans les détails tous les mécanismes en jeu et le rôle de chaque (type de) bactérie», à l’aide des techniques de biogénomique les plus poussées. Mais atteindre ce niveau de connaissances est-il indispensable pour imaginer une boucle complète de recyclage? «L’objectif est de simplifier au mieux tous nos modèles, répond Francesc Godia, responsable de Melissa à l’UAB. Pour le faire correctement, il faut d’abord obtenir un maximum de détails.»
Dix commandements
Au final, les défis sont multiples pour développer ce que ces spécialistes appellent des «systèmes de support de vie». Siegfried Vlaeminck, de l’Université d’Anvers, les a bien résumés en citant les «dix commandants» à suivre: les rendre très efficaces, compacts, légers, robustes, compatibles avec l’environnement spatial, consommant peu d’énergie et d’intrants chimiques, dotés de réserves restreintes, imposant peu de risque à l’équipage et lui demandant peu d’entretien.
Lors du symposium, d’autres aspects liés à ces habitats clos ont été évoqués, comme leur ergonomie ou les matériaux nécessaires pour les construire: «L’environnement spatial est différent, avec par exemple des différences de température énormes, a expliqué Christophe Lasseur. Les matériaux doivent ainsi être légers et facilement déployables, autoréparants (avec des colles internes se libérant lors de déformations), thermiquement peu réactifs, et évitant toute condensation à leur surface, donc aussi toute accumulation bactérienne.» Autant de sujets qui occupent les scientifiques.
Et autant d’avancées qui sont «intéressantes parce qu’elles pourraient être aussi utiles sur la Terre», avise Oliver Botta, du Swiss Space Office, en expliquant que la Suisse soutien le projet Melissa depuis 2012. A l’UNIL, le professeur d’écologie industrielle et co-organisateur du colloque Suren Erkman voit «clairement une convergence des recherches entre ces deux domaines». Et l’expert d’indiquer que les avancées dans le recyclage de l’eau sont déjà exploitées depuis dix ans dans des «habitats clos» terrestres, comme la station Concordia située en Antarctique.
Société créée à Lausanne
Longtemps vue comme singulière, cette vision, sur une Terre en mal de durabilité, intéresse de plus en plus les milieux économiques. En 2005 a été créée IPStar, agence visant à favoriser les transferts de technologies du programme Melissa. Et en 2013, la société Estee a été fondée à Lausanne, et collabore notamment avec des membres de Biosphere2. «Notre mission est de jouer les facilitateurs pour faire émerger et commercialiser plus rapidement des applications terrestres de ces recherches destinées au spatial», explique son directeur, Théodore Besson, ancien chercheur de l’UNIL pour laquelle il a réalisé une vaste étude sur le sujet, et co-organisateur du colloque.
Celui-ci a débouché sur les recommandations de planifier la construction d’un démonstrateur d’écosystème habitable clos bien réel, qui pourrait être occupé par des humains, serait pensé de manière architecturalement inédite et doté de performances énergétiques abouties ainsi que d’un système de domotique personnalisé gérant les interfaces homme-machine.