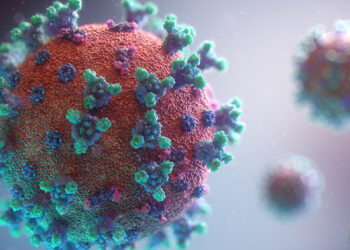Après les «tests diagnostiques» visant à détecter la présence du nouveau coronavirus chez les patients, les tests sérologiques, dont l’objectif est de déceler dans leur sang les anticorps (soit la réaction de leur organisme face à l’infection par le Sars-CoV-2), sont sur le point d’être déployés en Suisse. Notamment à Lausanne (CHUV) et dans le cadre d’une étude à Genève (HUG), a appris Heidi.news.
Pourquoi c’est important. A un niveau de santé publique, ces tests sérologiques pourraient permettre de mieux estimer le pourcentage de personnes dans la population ayant déjà été touchées par COVID-19, qu’elles aient ou non développé les symptômes de la maladie, avec ou sans hospitalisation. Une information cruciale pour déterminer les prochaines mesures à prendre. Et au niveau des patients, ces tests doivent permettre d’éclaircir les cas bizarres où il y a un soupçon d’infection non découverte par les tests diagnostiques, d’obtenir des indications sur les chances des patients à bien se remettre, d’étudier l’immunité de la population face au virus, voire de mieux évaluer l’effet des traitements en cours d’investigation.
De quoi on parle. Les tests sérologiques n’ont pas été utilisés jusque-là pour trois raisons:
- Face à ce genre d’épidémie, il s’agit en premier lieu de détecter chez les patients la présence du nouveau virus; c’est le but des tests diagnostiques, dit RT-PCR, largement effectués aujourd’hui.
- Ensuite, les tests sérologiques doivent traquer dans le sang des (anciens) patients les anticorps que l’organisme a développé en réaction à l’infection; or cette étape prend quelques jours, sept au minimum, plus généralement une dizaine.
- Enfin, il a fallu développer ces tests. Notamment sur la base des expériences acquises lors de précédentes épidémies (SARS en 2003 ou MERS-CoV en 2012).
De nombreuses (petites) sociétés dans le monde, surtout en Chine, s’y sont attelées. Où et combien? Catharina Boehme, directrice de FIND (Foundation for Innovative New Diagnostics), une fondation basée au Campus Biotech, à Genève, qui suit le développement de tests pour les maladies émergentes:
«A ce jour – et nous mettons à jour nos données quotidiennement – nous avons dénombré 56 sociétés dans le monde commercialisant des tests sérologiques pour le Sars-CoV-2, dont 46 ont déjà obtenu le label de certification européen CE. Les avancées ont été très rapides. Il y a une réelle course.»
A noter ici, comme le détaille Gilbert Greub, directeur de l’Institut de microbiologie du CHUV, que tous ces tests ne sont pas strictement identiques, certains étant adaptés à de gros volumes d’échantillons (ELISA) tandis que d’autres sont propres à des examens personnalisés (tests immunochromatographiques), sans même parler des différentes molécules (protéines) utilisées comme cibles.
Certains de ces tests sont décrits en détails dans des articles scientifiques. Le dernier en date, mis au point par des chercheurs de l’Icahn School of Medicine au Mt.Sinai Hospital de New York, a fait l’objet d’un preprint publié en fin de semaine dernière, qui met à disposition la procédure pour le répliquer.
L’utilité. L’étendue de ces tests sérologiques, par ailleurs moins coûteux que les tests diagnostiques, est large, et à regrouper dans deux catégories.
Au niveau de la santé publique:
- Disposer d’une estimation plus claire de la présence de l’infection virale au sein d’une population. Si besoin par tranche d’âge, par groupes professionnels, etc. De quoi mieux guider les décisions futures pour gérer l’épidémie. Aujourd’hui plusieurs pays (dont la Suisse) ayant dû renoncer à pratiquer systématiquement les tests diagnostiques ont perdu cette vision sur leur situation nationale.
- Etudier l’efficacité des thérapies actuellement utilisées.
- Etudier la durée de l’immunité face au virus acquise par une personne infectée. Catharina Boehme:
«Aujourd’hui, pour estimer la durée de l’immunité humaine au Sars-CoV-2, on ne peut que se baser sur des extrapolations avec des virus précédents similaires. On pense que, dans le cas de Covid-19, cette immunité acquise est de quelques mois, voire plus d’une année, mais certainement pas à vie. Par contre, on pense aussi qu’en cas de réinfection, les symptômes seraient moindres.»
Au niveau personnel:
- Eviter les «faux négatifs» et assurer qu’un patient fortement soupçonné d’avoir été infecté, mais répondant négativement au test diagnostique, a bel et bien été contaminé.
- Remettre au travail les patients ayant développé une immunité, par exemple les soignants; «cependant, aujourd’hui, on ne sait pas si les soignants avec sérologie positive seront protégés d’une réinfection, ni pour quelle durée», précise Gilbert Greub.
- Obtenir une meilleure indication pronostique pour le patient. Gilbert Greub:
«Si l’on observe que ceux qui développent rapidement des anticorps vont, au final, en général mieux que ceux chez qui l’apparition des anticorps est plus tardive, on pourra à terme utiliser la sérologie pour mieux adapter les soins.»
- «A terme, lorsqu’un vaccin devrait être disponible (probablement d’ici 12 à 18 mois), vacciner en priorité les personnes qui n’ont pas été infectées avant, et donc qui n’ont pas été naturellement immunisées», indique Didier Trono, professeur de virologie à l’EPFL.
La fiabilité. C’est la faiblesse actuelle de ces tests sérologiques, mis en place dans l’urgence. Catharina Boehme:
«Nous avons pour l’heure peu de bonnes données cliniques quant à la fiabilité absolue des tests sur le marché. Le problème a résidé dans le fait que les fabricants de ces tests n’avaient jusque-là pas un accès facile à beaucoup d’échantillons pour les tester. Et les organes de régulations étaient surchargés. Il s’agit maintenant de mener des évaluations indépendantes à ce sujet. Nous y travaillons, en étroite collaboration avec l’OMS. Les premiers résultats devraient être disponibles à la fin de cette semaine.»
Deux paramètres sont à vérifier de près :
1. Sensibilité. Le test permet-il bien de détecter TOUS les patients ayant développé des anticorps. Et donc d’éviter au maximum tant les «faux positifs» que les «faux négatifs».
2. Spécificité. le test reconnaît-il bien les traces du nouveau coronavirus Sars-CoV-2, et pas celles d’un autre coronavirus (il y en a quatre, connus de longue dates, largement en circulation, ces coronavirus saisonniers étant la deuxième cause des rhumes, après le rhinovirus). «De surcroit, il peut y avoir d’autres causes de faux positifs, par exemple des réactions croisées avec d’autres microbes que des coronavirus», précise le professeur Greub.
Selon Catharina Boehme, actuellement, les tests sérologiques ont des valeurs de sensibilité de 90% pour également 90% de spécificité. «Or, pour utiliser ces tests en diagnostique pour des patients, il faut atteindre quasi 100% de sensibilité; 97 à 98% selon les recommandations de l’OMS.» Pour la spécificité, par contre, la précision importe un peu moins, car la solution consiste à passer à un test diagnostique plus spécifique toute personne testée sérologiquement positive, afin donc, si besoin, de connaître précisément l’identité du virus l’ayant infectée.
Gilbert Greub indique alors que le CHUV, à Lausanne, est sur le point d’évaluer six tests sérologiques:
«Nous testerons aussi la spécificité de ces tests en y soumettant des échantillons de sang récoltés avant décembre 2019, et qui porteront peut-être des traces de certains anciens coronavirus, mais en principe pas du Sars-CoV-2.»
Par ailleurs, le microbiologiste révèle que le CHUV souhaite évaluer si ces tests corrèlent avec le pronostic des patients. «En effet, la présence d’anticorps paraissait être un facteur pronostic, dans une étude sur un autre coronavirus (MerS-CoV)».
Le déploiement. L’utilité la plus urgente et évidente de ces tests est d’évaluer la réelle dispersion du virus Sars-CoV-2 au sein de la population.
A cet égard, Didier Trono annonce être en contact avec des collègues aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) qui vont mener bientôt une étude au sein de la population romande:
«L’idée est d’échantillonner la population de manière aléatoire, et de leur faire passer des tests sérologiques acquis à l’étranger. Cela nous dira si seulement quelques pourcents de cette population a déjà été infectée ou si le pourcentage est de l’ordre d’une ou plusieurs dizaines de pourcents, ce qui signifierait que le virus est plus largement présent que suspecté, surtout chez un grand nombre de patients asymptomatiques. C’est une donnée importante pour décider des meilleures stratégies de contrôle de l’épidémie dans les semaines qui viennent.»
Idris Guessous, médecin-chef du service de médecine de premiers secours aux HUG donne plus de détails:
«Nous allons utiliser le Bus-Santé, qui sillonne la campagne genevoise pour faire des études épidémiologiques populationnelles et s’adresser aux patients en continu, afin de recruter plus d’un millier de personnes et d’évaluer leur réponse immunitaire au nouveau coronavirus. Nous sommes en train de déterminer le mode d’échantillonnage (aléatoire, ou ciblé sur des populations à risque).»
Or ne faut-il pas justement d’abord évaluer la fiabilité de ces tests? Catharina Boehme: «Celle-ci est suffisamment haute pour mener ce genre de vaste étude séro-épidémiologique visant à nous donner une image de surveillance aussi réelle que possible de la pandémie.» A titre d’exemple, Singapour est l’un des pays qui utilise déjà ce genre de tests à large échelle pour établir un programme national de surveillance.
De son côté, Gilbert Greub n’exclut pas qu’une telle étude séro-épidémiologique soit également mise sur pied rapidement dans le canton de Vaud en coordination avec le médecin cantonal: «Nous pourrions par exemple mieux évaluer la prévalence du virus chez les tranches d’âge les plus à risque, entre 50 et 80 ans.»
Comment choisir les participants à une telle étude? «Aléatoirement, parmi tous les citoyens du canton. Ou alors cibler des groupes de personnes à risque souffrant de maladies chroniques (dialyse par exemple)», qui se rendent régulièrement à l’hôpital à cet égard.
A partir de l’échantillon de personnes testées, les scientifiques peuvent alors estimer, grâce à des modélisations, l’extension de l’épidémie au sein de toute une population, ou un groupe particulier. Comme lors des sondages politiques avant des votations ou des élections en somme.
Thérapies possibles. Ces tests sérologiques pourraient aussi aider à mettre au point de nouvelles thérapies, basées notamment sur la transfusion de sérum contenant les anticorps générés par un patient guéri à un patient luttant fortement contre l’infection. Gilbert Greub:
«L’administration d’immunoglobulines a été utilisée pour lutter par exemple contre l’hépatite A avant l’avènement de vaccin; il s’agit comme pour Covid-19 d’une maladie qui est moins sévère chez les enfants que chez les aînés, davantage touchés. Ce sont là des questions ouvertes et des perspectives intéressantes. Il est ainsi d’autant plus important de disposer de plusieurs tests sérologiques, qui réagissent à différentes protéines, pour évaluer les réponses anticorps et cette future possibilité thérapeutique. Ce type d’approche a été testée à l’époque lors de l’épidémie de Sars-CoV-1.»
Des autotests? Pour Catharina Boehme, l’engouement autour de certains tests sérologiques immunochromatographiques, plus faciles d’utilisation, est tel que plusieurs sociétés développent déjà des auto-tests, à acheter en pharmacie et à faire chez soi. «Ils pourraient être disponibles sous peu.»
Idris Guessous:
«Cette approche est très intéressante. Nous sommes nous-mêmes en train de travailler avec une société qui développe un tel test, pour le valider. Pouvoir faire de tels tests à domicile risque d’être extrêmement important, car certains pays ont indiqué n’accepter de lever les mesures de confinement pour certaines personnes que sur la base de la preuve de l’existence, chez elles, d’une réponse immunitaire au virus.»
L’avis de l’OFSP. Questionné sur le sujet général des tests en conférence de presse le 23 mars, Daniel Koch, qui mène la lutte contre la pandémie en Suisse, a indiqué, concernant les tests sérologiques:
«On espère qu’il y aura, dans un futur proche, sur le marché des tests sérologiques. Il y en a certains qui sont sérieux: on est en train de vérifier, avec les spécialistes, lesquels sont vraiment fiables. Ces tests, s’ils sont massivement à disposition un jour, présenteraient aussi l’avantage de pouvoir tester les gens qui ont passé par le stade de la maladie mais en ont guéri. Cela nous permettrait de savoir quelle partie de la population a subi la maladie. On n’est toutefois pas encore si loin. On y travaille.»
Gilbert Greub explique cette relative retenue:
«Ces tests ont l’inconvénient de nécessiter une prise de sang. De plus, ils nécessitent du personnel formé. Il faut donc à chaque fois se demander si l’implémentation d’un nouveau type de tests (en l’occurrence sérologique) se justifie, et s’il ne dégarnit pas trop nos équipes de laboratoire. C’est pour cette raison que nous avons mis dans un premier temps toute notre énergie sur les tests diagnostiques RT-PCR. Dans le cas présent, les tests sérologiques me paraissent utiles et c’est aujourd’hui justifié de les implémenter à brève échéance. Ces tests feront partie de l’arsenal diagnostic pour lutter contre la pandémie.»