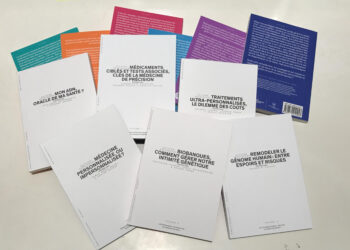![]()
Une nouvelle technique de génie génétique, baptisée Crispr-Cas, est au cœur de l’une des plus grosses disputes scientifico-économiques jamais connues. Des milliards sont en jeu
C’est la bataille de la décennie dans le monde des biotechnologies. Une nouvelle méthode de génie génétique est au cœur d’une guerre de brevets sur laquelle la justice américaine vient d’accepter de se prononcer. Une dispute d’une rare ampleur, qui se raconte comme un polar, avec son intrigue, ses implications pour l’avenir de la médecine, ses enjeux financiers faramineux, ses protagonistes charismatiques ou mystérieux, présents la plupart à la récente conférence scientifique AAAS, à Washington. Une affaire dont le décor se situe surtout aux Etats-Unis, mais avec des ramifications en Europe et en Suisse.
Les acteurs
Martin Jinek est aujourd’hui professeur de biochimie à l’Université de Zurich. Son post-doctorat, il l’a fait dans le groupe de biologie moléculaire de Jennifer Doudna, à l’Université de Californie à Berkeley. C’est à cette institution et à sa professeure qu’il a dû, selon les règles, céder les droits sur la découverte qu’il coréalise. Et quelle découverte! Celle d’une manipulation permettant, comme avec des ciseaux et de la colle, de sectionner l’ADN de cellules et d’y glisser un gène externe, doté des propriétés souhaitées. De quoi imaginer une palette d’applications: des semences agricoles améliorées aux «bébés sur mesure», en passant par des cobayes génétiquement modifiés pour mieux étudier les maladies. Une révolution, tant cette technique de «couteau suisse biologique», dite Crispr-Cas, est simple, précise, rapide et peu coûteuse.
Le groupe américain n’a pas fait cette trouvaille par hasard. Il a été mis sur sa piste par Emmanuelle Charpentier, microbiologiste française travaillant aujourd’hui au Max-Planck Institut de Berlin et à l’Université suédoise d’Uméa. Celle-ci a détaillé comment certaines bactéries bloquent des virus qui veulent y infiltrer leur matériel génétique. Une parade dont la chercheuse peinait toutefois à décrire seule la structure des armes utilisées, des enzymes et des protéines; elle a donc approché le groupe Doudna, dont c’était la spécialité. Le trio Doudna-Charpentier-Jinek publie en 2012 un article retentissant dans la revue Science, qui explique la technique Crispr-Cas, basée sur ce système de défense bactérien. Les deux professeures reçoivent pour cette avancée moult prix, et on leur prédit le Nobel.
Presque simultanément, un autre chercheur, Feng Zhang, au Broad Institute du MIT de Boston, utilise aussi Crispr-Cas pour l’appliquer, lui, à des cellules ayant un noyau (eucaryotes), à l’inverse des bactéries. En l’occurrence des cellules humaines et de souris. Et c’est là que la bataille commence.
L’imbroglio
Vu ses promesses, la technique Crispr-Cas et ses dérivés ont déjà fait l’objet d’une myriade de brevets de détails. Les investisseurs se pressent pour placer leurs milliards sur les firmes qui se profilent dans cet eldorado biotechnologique. Mais pour la paternité de la méthode et son exploitation commerciale, le débat fait rage.
Les deux équipes avancent une demande de brevet provisoire en 2012, celle de Doudna la première. Puis celle-ci dépose sa version finale le 15 mars 2013. Feng Zhang, le 15 octobre 2013. C’est pourtant lui qui, en avril 2014, qui se voit octroyer le premier une patente de l’Office américain des brevets, à la surprise de tous! Pourquoi? Pour deux raisons, car Feng Zhang et le Broad Institute sont malins.
La première est que le chercheur a utilisé la possibilité d’un «examen accéléré». Celui-ci implique des contraintes et coûte plus cher, mais permet, en cas d’acceptation, d’avoir un brevet en moins d’une année, contre plusieurs sinon. Dans le camp Doudna-Charpentier, on n’y a pas recouru, car leurs institutions académiques peinaient alors à accorder leurs violons.
La seconde raison est plus subtile. Elle se base sur un changement de fonctionnement de l’Office américain des brevets. Dès le 16 mars 2013, celui-ci a adopté un système donnant la primauté, en cas de requêtes similaires, à la date de dépôt. Mais sans effet rétroactif. Avant cela, c’est un autre critère qui faisait foi: le fait d’avoir concrétisé en pratique une découverte pour laquelle le requérant sollicite une patente. Or Feng Zhang, bien qu’il ait déposé sa demande après Jennifer Doudna, affirme avoir montré avant elle que la méthode Crispr-Cas pouvait être utilisée sur des cellules humaines!
Le Rubicon franchi
Ce que Jennifer Doudna et l’Université de Californie contestent. Au point de saisir la justice américaine en 2015, lui demandant de lancer une «action en interférence», soit une révision de la décision prise en faveur de Feng Zhang. L’instance a accepté le 11 janvier 2016 de s’y astreindre. Cette fois, le Rubicon est franchi, car un accord à l’amiable n’a quasi plus aucune chance d’être conclu. A la justice d’établir la vérité historique, de vérifier les cahiers de laboratoires, et d’entendre parties, témoins et experts; les auditions doivent débuter en mars, mais toute l’affaire va durer des années.
Pour Rodney Sparks, conseiller en brevets à l’Université de Virginie, s’exprimant dans la revue Nature, ce combat judiciaire n’aurait que peu de sens si les protagonistes voulaient protéger uniquement leur découverte académique, tant une telle procédure se veut longue et coûteuse. Or justement, chacun des acteurs a (co-) fondé une ou plusieurs sociétés ambitionnant d’exploiter la technologie Crispr-Cas. Editas Medicine, que Zhang et Doudna ont coétablie ensemble avant que la chercheuse ne s’en retire, s’est même lancée en bourse en janvier dernier. Et Emmanuelle Charpentier utilise l’une de ses deux entités, Crispr Therapeutics, dont le siège est à Bâle, pour défendre ses droits d’inventeurs, ce qui ne simplifie pas les choses. «La Suède permet aux scientifiques de garder leur propriété intellectuelle au détriment de l’Université hôte», explique-t-elle au Temps. Et pourquoi Bâle? «Parce que la Suisse est connue pour son environnement propice à la fondation de compagnies biotech.» Au final, c’est donc bien un enjeu à plusieurs millions, voire milliards, de dollars que remportera celui qui se verra adoubé par la justice.
La scène s’enrichit
De tels montants font tourner bien des têtes. Ainsi, pour ne rien arranger, d’autres acteurs sont entrés dans la danse. Le généticien Eric Lander d’abord. Ancien conseiller scientifique de Barack Obama, il s’est fendu d’un article dans la revue Cell voulant retracer l’historique de la découverte de Crispr-Cas, mais relativise la contribution de Doudna-Charpentier. A leur grand dam. Or la revue a omis de mentionner que le Broad Institute, qu’Eric Lander dirige et où travaille Feng Zhang, est en conflit avec l’Université de Californie! Par ailleurs, la littérature spécialisée évoque un mystérieux troisième requérant dans l’action en interférence. En parallèle, les mêmes demandes de brevets en Europe font l’objet d’oppositions multiples. Enfin, des patent trolls, des entités rachetant des brevets mues uniquement par le profit (lire ci-dessous), rôdent déjà comme des hyènes autour de la scène.
Epilogue (provisoire)
Toutes ces péripéties portent-elles ombrage à ce domaine si prometteur? «Les montants investis dans Crispr-Cas se chiffrent en milliards, donc les investisseurs vont de l’avant. Aucun ne m’a dit ne plus vouloir être impliqué du fait de l’incertitude induite par cette guerre des brevets», dit Jennifer Doudna au Temps. Ce serait plutôt l’inverse: «Même les firmes pharmaceutiques nous disent qu’il serait plus risqué de ne pas investir…» «L’on voit des alliances se nouer entre ces dernières et les sociétés créées par les pionniers de Crispr-Cas», confirme Fabien Palazzoli, analyste chez IPStudies, société sise à Châtel-Saint-Denis et spécialisée dans la propriété intellectuelle.
Des deux côtés, on assure se focaliser surtout sur les recherches fondamentales. «Mon souci principal est que cette technologie puisse un jour aider [à soigner] des gens», dit Jennifer Doudna. «Lors de la publication dans Science, il était clair que la technologie serait utilisable par toute la communauté scientifique pour des recherches sans gain», ajoute Emmanuelle Charpentier. Au Broad Institute, sans vouloir commenter, l’on indique seulement «continuer à partager librement la technologie Crispr-Cas». Dans Nature, Jacob Sherkow, professeur à la New York Law School, ne croit pas que cet esprit de camaraderie académique prévaudra longtemps, tant les revenus tirés des brevets acquièrent de plus en plus d’importance pour les grandes institutions: «Nous vivons dans un autre monde aujourd’hui!»
L’arrivée des «patent trolls»
Des «chasseurs de brevets» jouent les trouble-fête dans l’attribution des droits de la technologie génétique révolutionnaire Crispr-Cas
La dispute autour de la technologie Crispr-Cas sera une guerre juridique complexe. Une bataille dans laquelle des «patent trolls», ou «chasseurs de brevets», vont aussi prendre part, estime Fabien Palazzoli, de la société IPStudies, basée à Châtel-Saint-Denis et spécialisée dans les affaires de propriété intellectuelle.
Les patent trolls sont des entités, discrètes et constituées d’une batterie d’avocats et juristes, qui rachètent des brevets et licences à tous vents, notamment d’entreprises en faillite. Ceci dans le but ensuite de les utiliser pour en faire une lucrative activité économique. «Ces patent trolls attaquent toute société tombant dans le collimateur de ces brevets, explique l’analyste. Elles lui proposent alors soit de payer un accord de licence «à l’amiable», soit de lui intenter un procès, très coûteux, et qui s’avère en général dissuasif.»
A fin janvier 2016, IPStudies avait analysé 489 familles de brevets autour de la technique Crispr-Cas, avec un certain flou les entourant. De quoi attirer les patent trolls: une société nommée Elwha LLC, spécialisée dans les patentes liées à l’informatique ou aux télécommunications, et appartenant au groupe Intellectual Ventures, le plus important agrégateur de brevets au monde, se montre déjà active autour de cette technologie «chirurgie du gène».
Qu’en pensent les principaux intéressés, ses inventeurs? «Ce sont des méthodes déplorables, pour nous scientifiques, focalisés sur la recherche, dit l’un d’eux, la Française Emmanuelle Charpentier. Cette surenchère des brevets détruit une belle histoire.» «Cela m’inquiète que des gens puissent acquérir des brevets pour en empêcher d’autres d’accéder à cette technologie, renchérit sa collègue américaine Jennifer Doudna, qui possède elle-même dix familles de brevets. Mais ce n’est pas unique à notre domaine. Et je n’ai pas de solution pour résoudre ce problème.»