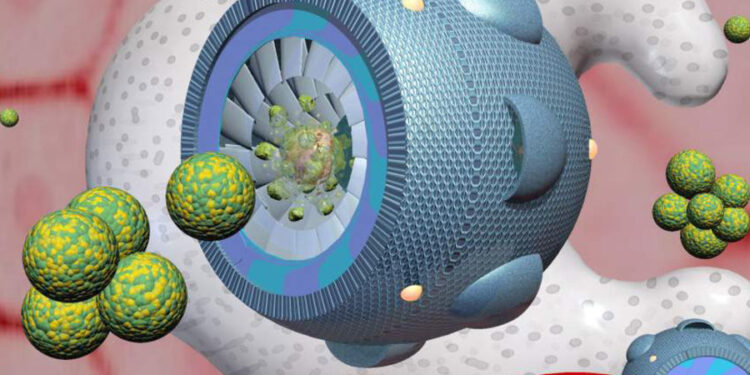![]()
Dans la recherche, les promesses (de résultats) sont-elles utiles? Efficaces? Stimulantes ou contraignantes? Un collectif de spécialistes, sous l’égide d’un politologue de l’Université de Lausanne, répond à ces questions
Sciences et technologies émergentes: pourquoi tant de promesses? C’est le titre d’un ouvrage issu d’un collectif d’auteurs, sous la direction de Marc Audétat, politologue et chercheur à l’Interface Sciences-Société de l’Université de Lausanne.
Vous parlez de «business des promesses» agissant comme une bulle spéculative qui se surimpose à la recherche. La situation est-elle si grave?
L’excès de promesses et la surenchère conduisent à des décisions plus politiques que scientifiques, à des espoirs déplacés; les promesses n’éclairent pas la vision des possibilités qui s’offrent à partir de l’état de l’art, elles l’obscurcissent. Ainsi, l’on finance mieux certaines recherches au détriment peut-être d’autres priorités. Le business des promesses crée un écran qui empêche ces dernières d’être évaluées.
Pour la sociologue Ulrike Felt, «vendre la science» ne peut plus être vu comme un luxe mais est devenu une nécessité. Pourquoi?
Elle a fait le constat, il y a vingt ans, que les fonds pour la recherche ne sont pas illimités ni assurés à jamais. Or depuis, avec les grands programmes de recherche qui allouent des sommes toujours plus larges sur une base compétitive, à l’instar du schéma européen Future and Emerging Technologies FET, doté d’un milliard d’euros, et qu’a remporté le Human Brain Project (HBP) à l’EPFL, on a vu se mettre en place un régime de promesses qui déborde sur l’ensemble du système de la recherche.
Quels sont les ressorts des promesses scientifiques?
Il faut rappeler que promesses et visions ont toujours été présentes dans le travail des sciences modernes. Or on pense qu’elles se contentent d’accompagner le travail scientifique. En fait, elles font bien plus, en ayant un rôle d’orientation et de coordination des efforts de recherche. En ce sens, elles façonnent les sciences et les techniques. Cela dit, la production de promesses a augmenté en raison de la compétition toujours plus dure pour capter les fonds, des ruptures technologiques qu’elles annoncent, de la croissance des services de communication, de la multiplication des analystes industriels qui répondent à la demande du capital-risque. Enfin, la circulation des promesses est devenue massive avec Internet et l’implication d’acteurs de toutes sortes.
N’est-ce pas ardu de résister aux promesses lorsqu’elles s’adressent aux espoirs les plus profonds de l’être humain?
Notre collègue américaine Sarah Franklin parle de «technologies de l’espoir» lorsqu’il s’agit de santé, de médecine reproductive ou du vieillissement, des domaines où il conviendrait d’observer un peu de retenue. Ce que n’a pas fait le HBP lorsqu’il a joué sur l’espoir de guérir les maladies neurodégénératives comme l’Alzheimer ou le Parkinson. Des arguments avancés durant la campagne de candidature FET que nombre d’acteurs ont trouvés abusifs.
Les promesses des chercheurs seraient aussi fortement conditionnées par celles des institutions qui les hébergent…
Sans doute, mais ils vivent et s’engagent dans ces promesses avec un idéal parfois très différent des buts recherchés par leur institution. Généralement, ils se montrent plus prudents quand on les interroge sur leurs travaux que les porte-parole de leur institution ou les entrepreneurs scientifiques. J’ai pu le constater sur le terrain de la nanomédecine et de la médecine personnalisée, qui postule que la génomique permettrait d’élaborer des médicaments adaptés aux spécificités des patients.
Selon vous, «les promesses ont aussi pour but de répondre à l’irréductibilité des incertitudes». Faire des recherches dont on ignore l’issue impose-t-il forcément de faire des promesses de résultats?
C’est bien là un des problèmes: la recherche n’aboutit pas forcément au résultat escompté au départ, mais elle progresse en ouvrant éventuellement une autre voie. C’est pourquoi la surmédiatisation de promesses, en créant des attentes et une exigence de résultat, peut bloquer la recherche et entraîner une perte de liberté. Du côté de l’innovation, où les incertitudes sont nombreuses, les promesses tendent à minimiser les obstacles et à exagérer les vitesses de réalisation. Certains affirment que le futur est déjà écrit, que le développement technologique est déterminé. Il ne faut pas être dupe.
Pour le sociologue Olivier Glassey, «les promesses peuvent avoir plusieurs vies». En quoi?
Mon collègue rappelle la crise des «.com» dont la valeur a chuté en l’an 2000 en raison de la promesse déçue de rentabilité des premiers services en ligne, et comment le «Web 2.0» a été conçu pour relancer cette promesse. Mais on peut penser aux promesses qui reviennent régulièrement: la maison automatisée, l’intelligence artificielle. Ou celle de remplacer les organes malades: on l’a oublié, mais on nourrissait cet espoir il y a vingt ans avec la xénotransplantation. Après la désillusion sont arrivées les cellules souches d’embryons. Il y a aussi des promesses pluricentenaires, puisque Francis Bacon, dans La Nouvelle Atlantide en 1627, parlait déjà de nouveaux matériaux, de nouvelles espèces et de prolongation de la vie. Mais les promesses peuvent être évaluées selon leurs performances et on observe aussi des cycles de crédibilité. La médecine personnalisée, par exemple, arrive semble-t-il au bout d’un cycle, et l’expression «médecine de précision» circule déjà pour lui venir en aide.
Pire, «une fois émises, les promesses scientifiques échappent à leur producteur», lit-on dans une analyse sur le transhumanisme…
Une fois portées à l’attention du public, les visions et promesses sont interprétées, réécrites, prolongées, incluses dans de grands récits du futur. Il n’est pas interdit de rêver.
N’y a-t-il pas un risque que le public se lasse de toutes ces promesses? L’intégrité de la science n’est-elle pas menacée?
C’est la crainte de nombreux chercheurs: l’exagération des promesses prépare les désillusions, qui peuvent conduire à des baisses de moyens. Et en ce sens, la science qui bénéficie des promesses peut aussi en être victime. C’est pourquoi les promesses les plus futuristes, qui trahissent des intérêts à court terme, dans le positionnement de la compétition pour les ressources financières, ont parfois un caractère factice ou désincarné.
Selon Pierre-Benoît Joly, directeur de recherche à l’INRA, c’est «le futur qui colonise le présent». Pourquoi?
Certaines promesses attirent toute l’attention et mobilisent des moyens qui créent un état de nécessité et empêchent de voir qu’il y a plusieurs avenirs possibles. Elles font écran à la vision des priorités possibles et court-circuitent la discussion qui devrait avoir lieu. Pour exemple, il rappelle comment la promotion des OGM pour résoudre des problèmes de la production agricole a eu pour conséquence de négliger d’autres solutions.
Va-t-on vers la fin de cette «ère des promesses»? Comment calmer le jeu?
Il n’y a pas de recette. Nous pouvons déjà exercer notre sens critique et promouvoir celui-ci chez les scientifiques euxmêmes et dans le public. On peut aussi chercher le moyen de réenchanter les promesses: il faudrait arrêter de concevoir la recherche comme exclusivement au service de l’utilité, du marché, et de la brevetabilité, et de voir la société comme un frein au progrès. En tout cas, le régime des promesses technoscientifiques paraît parfois déconnecté. Il faudrait préserver les autres types de recherche, y compris «fondamentale», promouvoir des travaux faisant une meilleure place aux enjeux sociaux et environnementaux, et encourager la participation d’un plus grand nombre d’acteurs concernés.