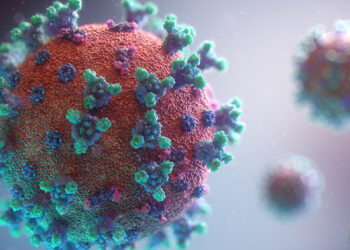La recherche clinique et pharmacologique tire à merveille profit des immenses et récents progrès effectués en génétique, qui permettent de relier des mutations génétiques, ou la présence d’un biomarqueur dans l’organisme, avec une action thérapeutique potentielle. Ceci avant tout en oncologie. Rien qu’aux Etats-Unis, un tiers des nouveaux médicaments validés depuis 2011 l’ont été sur des bases génétiques ou moléculaires.
La question. Bien que légitime, l’enthousiasme que soulèvent ces succès ne risque-t-il pas de restreindre le champ de focalisation recherches des pharmas? Comment, pour valider ces médicaments inédits, mener des essais cliniques de grande taille lorsque l’on sait que le génome est une sources de données éminemment personnelles, et non généralisables? Toute la population y aura-t-elle accès équitablement? Alors qu’une table ronde doit se tenir ce dimanche sur ce sujet lors des portes-ouvertes de l’EPFL, animée par ma collègue de Heidi.news Annick Chevillot, voici quelques pistes de réponses à ces questions, tirée d’un livre paru il y a peu dans la collection SantéPerSo.
L’ambition.
«On assiste à une révolution dans le traitement du cancer. Auparavant, un cancer métastasé menait le plus souvent à la mort. Aujourd’hui, dans de nombreux cas, grâce à la médecine personnalisée, on peut prolonger la vie durant des années, et peut-être guérir de ce type de cancer. »
Ces mots, prononcés à l’automne 2015 dans une interview au quotidien suisse Le Temps, sont ceux de Séverin Schwan, directeur exécutif de Roche. Voilà une perspective aux fondements autant scientifiques et pharmacologiques qu’économiques, affirmée on ne peut plus clairement par l’une des entreprises pharmaceutiques qui, après reconversion partielle, est devenue l’une des plus en pointe dans le domaine de la médecine de précision, aussi dite médecine personnalisée.
N’est-ce pas aussi une vision qui résonne un peu (trop ?) comme une promesse, à l’heure où brille cette médecine parfois considérée comme inédite mais qui reste avant tout basée sur la confluence récente des recherches de pointe en biologie cellulaire, des développements fulgurants dans les technologies des sciences de la vie (le séquençage d’ADN notamment) et – c’est vrai – des efforts renouvelés que seule peut assurer l’industrie pharmaceutique, en mal de nouveaux blockbusters?
Les domaines d’action. La recherche clinique est évidemment au premier rang pour éprouver cette révolution annoncée. Que ce soit d’abord, très concrètement, dans le domaine de l’oncologie, où moult nouveaux médicaments permettant des traitements plus personnalisés apparaissent effectivement depuis une décennie. «Dans le domaine des neurosciences cliniques aussi, des connaissances beaucoup plus fines des processus biochimiques et physiologiques impliqués dans certaines pathologies neurologiques ont ouvert des voies thérapeutiques plus ciblées», avance Patrice Lalive, responsable de l’Unité de neuroimmunologie et des maladies neuromusculaires aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).
De manière générale, ces premiers succès dans des champs bien définis doivent encourager «des recherches qui vont permettre, dans maints autres aspects de la santé au-delà de l’oncologie, une meilleure évaluation des risques de maladies, une compréhension accrue des mécanismes pathologiques et la prédiction d’une thérapie optimale, pour étendre encore les bienfaits de la médecine de précision», souhaite dans le New England Journal of Medicine Francis Collins, directeur des Instituts nationaux américains de la santé (NIH).
Le parfait exemple. Pour bien ancrer ce changement de paradigme dans la réalité, l’autorité américaine de validation des médicaments (la Food and Drug Administration, FDA), dans son rapport intitulé Paving the way for personalized medicine (trad.: Ouvrir la voie à la médecine personnalisée), cite l’exemple de la mucoviscidose. Cette maladie héréditaire provoque l’accumulation de mucus dans les voies respiratoires et digestives et aboutit à une insuffisance respiratoire généralement létale. Elle est due à l’apparition d’une mutation sur un gène précis du génome, nommé CFTR; il existe plus de 1900 mutations possibles. Or, en 2012, la FDA a validé un nouveau traitement touchant précisément une de ces mutations (G551D), responsable de 4% des cas de mucoviscidose. Selon la FDA, ce nouveau médicament, nommé Kalydeco™, est sans précédent à plus d’un titre:
- Les scientifiques qui l’on mis au point ont bénéficié de découvertes au niveau moléculaire quant à la dysfonction de certaines protéines en jeu dans la maladie, et ont pu développer une intervention pharmacologique pour y pallier, après avoir également développé un test génétique permettant d’identifier les patients les plus à mêmes de répondre à ce traitement. Autrement dit, grâce aux techniques génétiques, ils ont attaqué la cause de l’affection plutôt que visé ses symptômes, comme cela était le cas jusqu’alors.
- Le développement du Kalydeco n’a été rendu possible que par une collaboration étroite entre une fondation dédiée à la lutte contre la mucoviscidose (la Cystic Fibrosis Foundation) et l’entreprise Vertex Pharmaceuticals. La première entité a permis de réunir les patients en assez grand nombre pour, grâce aux efforts de la seconde, tester une molécule prometteuse.
- La FDA a approuvé ce nouveau médicament en un temps record, tant les intérêts de toutes les parties avaient été volontairement alignés, quand bien même cette forme de mucoviscidose est très rare.
Depuis lors, l’agence américaine dit avoir approuvé plusieurs dizaines de «thérapies ciblées» similaires, principalement des traitements contre le cancer, pour des patients dont les tumeurs ayant des caractéristiques génétiques spécifiques peuvent être identifiés par des tests idoines, inédits eux aussi. Et plusieurs centaines d’autres molécules expérimentales seraient désormais listées comme «candidates cliniques». John Mendelsohn, oncologue reconnu à l’Université du Texas, résumait déjà en 2013 dans un numéro spécial du Journal of Clinical Oncology (JCO):
«Il est tentant de dire que nous nous trouvons à un point d’inflexion dans l’accélération du traitement du cancer avec des thérapies ciblées, alors que jusqu’à récemment, les analyses génétiques n’étaient que rétrospectives, chronophages et très coûteuses».
Les potentialités de la recherche. Aujourd’hui encore, cette avancée autour du Kalydeco illustre parfaitement les potentialités de la recherche clinique et pharmacologique en médecine personnalisée. La principale est qu’elle tire à merveille profit des immenses progrès effectués en génétique ces dernières années, qui permettent de relier mutations génétiques, expression des gènes défectueux dans le génome et correction thérapeutique possible.
- D’ailleurs, d’après la FDA, environ un tiers des nouveaux médicaments validés sur l’ensemble depuis 2011 l’ont été sur la base de données génétiques ou moléculaires caractérisant l’efficacité de la substance active, sa sécurité ou sa pharmacocinétique, autrement dit ce qu’elle devient lors de son absorption par l’organisme.
- Un autre rapport, du Tufts Center for the Study of Drug Development, notait en 2010 déjà que plus de 90% des compagnies pharmaceutiques utilisaient une ou plusieurs cibles dérivées de la génétique dans leur programme de développement de médicaments.
«C’est dire l’importance qu’a pris l’analyse du génome dans ce domaine, au carrefour de la science et de l’économie», ne cesse de souligner Jacques Fellay, chef de l’Unité de médecine de précision au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) à Lausanne, professeur de génomique à l’École polytechnique fédérale de Lausanne et codirecteur sur le Campus Biotech à Genève du Health 2030 Genome Cancer Center, la première plate-forme de séquençage de l’ADN à haut débit de Suisse, appelée à devenir l’une des plus importantes en Europe en termes de capacités, selon l’Université de Genève.
Plusieurs défis. Cet enthousiasme largement partagé dans la communauté scientifique doit être tempéré par la nécessité, d’abord, de relever plusieurs défis.
Le premier est de ne pas restreindre les recherches à ce que le philosophe des sciences Xavier Guchet appelle une «médecine des biomarqueurs», ces molécules trouvées dans le sang, les fluides ou les tissus qui signalent un processus normal ou pathologique et qui peuvent être autant de tests diagnostiques ou de cibles pour de nouveaux médicaments. Il s’agit en effet toujours d’abord d’établir un lien de causalité aussi étroit que possible entre ces biomarqueurs et une (absence de) maladie, lien qui va au-delà de leur simple corrélation, puis de mettre au point des tests directement liés à ces biomarqueurs, tests devant être efficaces et fiables. Et, même dans l’hypothèse où ce champ se développerait à l’envi, Stefan Sleijfer, dans la même édition du JCO., recadre:
«Ce paradigme de la médecine personnalisée – prétendre soigner les patients uniquement selon leur profil génétique ou des indications moléculaires données – est challengé par le besoin d’effectuer des dépistages moléculaires très larges en utilisant des techniques validées dans des laboratoires certifiés, mais tout ceci avec des ressources en temps et en argent qui ne soient pas prohibitives».
Ce d’autant plus que la production de quantités énormes de données – génétiques d’abord, mais aussi de toutes autres natures concernant le fonctionnement du corps humain – quasi routinière lors d’examens prospectifs va rendre les tâches d’analyses extrêmement complexes. José Baselga et ses collègues du Memorial Sloan Kettering Cancer Center de New York, l’expliquent en février 2017 dans la revue Cell:
«Historiquement, le développement de la médecine des biomarqueurs a toujours commencé par une découverte de base, suivie d’une confirmation biologique de la cible, et culminé dans le test d’un médicament, expliquent. Malgré les succès de cette façon de faire jusque-là, elle n’est, pour des questions de temps, pas pratique» devant le déluge d’informations fournies par les nouvelles technologies.
Des données qui concernent qui plus est souvent des groupes de patients similaires restreints et très éclatés de par le monde.
C’est là qu’interviennent alors des systèmes d’intelligence artificielle, permettant de se plonger rapidement dans une ou plusieurs bases de données pour relier des cas, et tirer des conclusions pertinentes selon une méthodologie qui prendrait aux humains une éternité. Un seul exemple récent? Un algorithme de «machine learning » développé en 2017 en Angleterre par des chercheurs de la Warwick’s School of Engineering permettrait de prédire avec 99 % d’efficacité, sur la base d’une poignée de cas ou simulations de références seulement, si une molécule médicamenteuse candidate va bien se lier à la protéine-cible souhaitée.
Essais cliniques chamboulés. Cette effervescence scientifico-technologique implique parfois que «la validation clinique d’une cible thérapeutique survienne avant que tous les mécanismes biologiques fonctionnels ne soient décryptés», poursuit José Baselga. Avec pour conséquence collatérale de chambouler les essais cliniques traditionnels mis sur pied par l’industrie pharmaceutique.
Si l’on se focalise sur l’oncologie, les avancées ont été telles que, selon le spécialiste, «les caractérisations génomiques détaillées des tumeurs sont en train d’induire la définition d’une nouvelle taxonomie des cancers chez l’homme, qui complémentera l’actuelle classification basée sur l’histologie », soit l’étude des seuls tissus.
Autrement dit, explique Pierre-Yves Dietrich, chef du Département d’oncologie des HUG:
«Au lieu de regrouper les malades par type de cancer (sein, poumons, prostate, etc.), on va les considérer en fonction du profil génétique de leur tumeur, indépendamment de l’organe que celle-ci affecte ».
Une personne souffrant d’un cancer du sein et une autre atteinte d’une tumeur aux poumons pourraient ainsi recevoir un médicament identique, alors que leurs traitements oncologiques respectifs auraient jusque-là été très différents. José Baselga:
«Des essais cliniques basés sur des considérations purement génétiques, dessinés pour évaluer des hypothèses issues des laboratoires, peuvent aussi permettre d’identifier des cibles nouvelles qui n’ont pas encore été examinées en détail biologiquement. Ce qui peut accélérer la mise au point de médicaments inédits ! »
La méthodologie scientifico-médicale elle-même s’en trouve chamboulée. En effet, les très larges et robustes statistiques liés à de grands nombres de patients, qui constituaient l’un des socles de la « médecine basée sur les preuves » (ou evidence based medicine), ne sont souvent plus réalisables. Dès lors, chez les cliniciens aussi on assume le côté largement empirique de la démarche. «C’est pourquoi il s’agira de récupérer un maximum d’informations pertinentes à partir de chaque patient, et surtout ensuite de mettre celles-ci en réseau», conclut José Baselga. De quoi, là aussi, remodeler les travaux de l’industrie pharmaceutique autant que la recherche clinique dans son entier.
Quelles stratégiques les plus efficaces. À ces défis s’en ajoutent d’autres: quelles stratégies thérapeutiques seront-elles les plus efficaces sur le long terme si l’on tient compte de l’hétérogénéité des tumeurs, de leur caractère mutagène ou du fait qu’elles acquièrent des résistances aux médicaments? Quel poids donner à la caractérisation des éléments purement génétiques déterminant un cancer, en regard de ceux qui dépassent l’ADN (comme les indications épigénétiques, partiellement dues aux effets de l’environnement sur l’expression du génome)? Et comment inscrire dans la clinique les technologies d’analyses qui y sont liées? Enfin, comment adapter l’évaluation de l’efficacité de médicaments proposés par l’industrie pharmaceutique, nouveaux ou anciens car ressortis des étagères après des premiers essais infructueux, ainsi que leur prise en charge économique?
Teintée d’une myriade de promesses thérapeutiques, dont pour certaines la concrétisation s’est déjà avérée, c’est à toutes ces questions encadrant les réalités quotidiennes de la quête d’une santé améliorée pour chacun que doit répondre la recherche clinique en médecine de précision, à travers tous ses acteurs, les scientifiques et les patients, l’industrie pharmaceutique, et les autorités de régulation.
Ce texte est l’introduction de l’ouvrage: Médicaments ciblés et tests associés, clés de la médecine de précision, Olivier Dessibourg, Collection Santé Personnalisée, Ed.PlanèteSanté/Médecine&Hygiène, 2018.
Le 15 septembre 2019 à 13h, au Forum Rolex de l’EPFL, se tiendra la table ronde «Cancer – therapies personnalisées», avec Krisztian Homicsko (EPFL), Athina Stravodimou (CHUV), Bettina Bisig (CHUV), Edoardo Missiglia (CHUV) et Vincent Zoete (UNIL). Animation: Annick Chevillot, Heidi.news