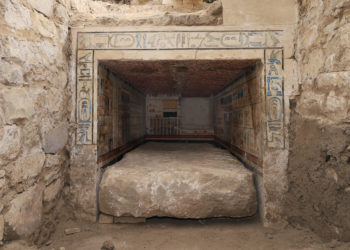![]()
Le professeur de l’Université de Genève présidera dès janvier 2012 l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT). Outre le cosmos, son autre univers de prédilection, c’est la voile
«Le Club nautique de Versoix est fermé? Bon, retrouvons-nous alors à la buvette de la plage de Mies (VD). Vous ne pouvez pas la manquer, depuis la route: il y a plein de bateaux à côté.» Le décor est vite posé. Même s’il n’est pas un fidèle de cette gargote protégeant l’entrée d’un minuscule port de plaisance, Thierry Courvoisier tenait à ce que ce déjeuner se déroule sur les rives du Léman; la voile est un de ses deux univers de prédilection.
«Jadis, avec mon épouse, nous faisions le tour du lac pour participer à la régate des vieux bateaux de La Tour-de-Peilz.» Aujourd’hui, c’est plutôt vers le grand large qu’il aime larguer les amarres: «Entre 2009 et 2010, nous avons fait le tour de l’Atlantique à bord de Cérès, notre voilier de 40 pieds», confie-t-il en levant son verre de Tartegnin, comme pour rendre hommage à ce «fantastique vecteur de découverte».
L’autre univers dans lequel se plonge ce sémillant quinquagénaire s’écrit avec un grand U. Thierry Courvoisier est professeur d’astrophysique à l’Université de Genève, et directeur de l’ISDC, un centre qui traite les données pleuvant d’Integral, un satellite traquant les événements parmi les plus tumultueux du cosmos, tels les «sursauts gamma». Un institut qu’il a participé à fonder dès 1993 à Versoix, le bourg voisin. Sa carrière lui vaut aujourd’hui d’avoir été choisi pour prendre pour trois ans la barre de l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT), dès 2012. Sourire empreint de modestie mais de fierté aussi, derrière la carte des mets, quand on le lui rappelle.
Cette casquette vient s’ajouter à celle de président de la Société européenne d’astronomie et d’éditeur d’Astronomy & Astrophysics Reviews, «une publication très attentive à être accessible à l’ensemble de la communauté astronomique, et qu’apprécient aussi les enseignants», qui y trouvent matière abordable pour leurs cours. «Car un savoir qui n’est pas partagé n’est pas intéressant…»
Communiquer, transmettre, diffuser des connaissances: c’est un des objectifs principaux de ce mandat de présidence pour ce chercheur que l’on dit engagé. «En y réfléchissant, j’ai fait plusieurs constats, lance-t-il en harponnant sa salade mêlée. Le premier est que, si la technologie est souvent bien perçue à travers les objets du quotidien, tout le savoir scientifique qu’il y a derrière est méconnu. Prenez le GPS: cette technologie recourt jusqu’à la relativité d’Einstein pour fonctionner. Il y a clairement un déficit de connaissances scientifiques dans la population. L’homéopathie est un bel exemple. Des dizaines d’études ont montré que cette méthode n’était scientifiquement pas fondée. Pourtant, elle va être à nouveau remboursée par l’assurance maladie de base.»
La pilule est pour lui aussi difficile à avaler que les feuilles de verdure un peu trop vinaigrées. «On devrait s’indigner de ce genre de chose, pas les accepter. En laissant perdurer, pire en validant des croyances qui sont fausses, on décrédibilise ce qui est juste.»
Le capitaine de la SCNAT en veut-il au conseiller fédéral Didier Burkhalter d’avoir imposé cette disposition? «Je m’étonne que l’on puisse prendre des décisions aussi éloignées du bon sens scientifique. Et cela m’amène à un autre constat: il y a trop peu de culture scientifique autour de nos instruments de décision à Berne, tant parmi les politiciens que parmi les journalistes. Le cas du retrait du nucléaire est éloquent: on a plus parlé des clivages politiques entourant ce sujet que du sujet lui-même. Cela d’autant plus que – dernière observation – il n’est quasiment plus aucun domaine scientifique qui ne soit lié à un pouvoir, politique, mais aussi économique ou militaire.»
En quelques doigts brandis, Thierry Courvoisier, tout en dégustant son filet de féra aux chanterelles, a dressé le plat de résistance de son triennat de présidence. Comment va-t-il l’apprêter? «Il faut mener une vraie réflexion sur la place des chercheurs dans la société. Ceux-ci pensent qu’il leur suffit de présenter leurs travaux au public. C’est très bien. Mais cela ne répond pas forcément aux questions des gens, des politiciens. Il faut aussi avoir le courage d’écouter les besoins de ceux-ci. Quant aux médias, il serait souhaitable qu’ils s’imprègnent davantage de ce qu’est le savoir scientifique, de ce qui constitue ses règles et ses valeurs, afin de développer une curiosité critique.»
Selon lui, les académies ont un rôle à jouer pour valoriser les éléments de base de ce dialogue décisionnel commun. «Cette démarche doit déjà commencer à l’école, car le savoir scientifique constitue le fonds de notre culture, au même titre que la littérature. Les sciences sont parfois difficiles d’accès, mais l’école doit avoir des exigences, et ne pas miser uniquement sur l’envie d’apprendre.»
Sa propre route scolaire, ce corsaire des sciences aime à dire qu’il l’a tracée «en tirant des bords»: latin au cycle d’orientation, maturité scientifique au Collège Calvin, doctorat en physique théorique à l’Université de Zurich, puis cap vers l’astrophysique, le cosmos et ses secrets.
Une fois la féra et ses frites englouties dans les flots de ses futurs défis à la SCNAT, deux expressos et les ultimes gorgées de vin ouvrent l’horizon à des élans plus métaphysiques. «L’astrophysique est un outil essentiel pour comprendre notre identité propre, notre Weltanschauung. Depuis Copernic, on sent que le jugement de nos actions est différent suivant que l’on est au centre du monde, comme on le pensait jadis, ou que l’on vogue sur un des milliers d’astres de l’Univers. De même, l’image d’un ciel immobile avait formaté notre façon d’être. Or depuis cinquante ans, depuis que l’observation astronomique s’est ouverte au spectre électromagnétique, l’image qui nous parvient de l’Univers montre un tableau précaire et dynamique, riche d’explosions, d’implosions violentes. Cette image va petit à petit pénétrer dans le collectif, l’idée d’éternité va disparaître. Le changement va faire partie de nos valeurs fondamentales bien plus que l’immuabilité.»
A propos d’astres, quel regard porte l’explorateur des mers sur ces nouveaux mondes du cosmos que sont les planètes extrasolaires, dont la première a été découverte par Michel Mayor et Didier Queloz, deux autres astronomes genevois? «La première édition de l’Encyclopædia britannica mentionnait déjà l’existence probable de ces exoplanètes. Au risque de froisser mes collègues, il y a des concepts bien plus révolutionnaires en astrophysique, comme ceux de la matière et de l’énergie sombres, qui occuperaient 96% de l’Univers, mais dont on ignore tout de la nature.»
Mystère donc, dit-il en lorgnant le fond de sa tasse de café. Et celui des neutrinos du CERN, susceptibles de filer à une vitesse plus grande que celle de la lumière, et qui pourraient torpiller les belles théories d’Einstein? «Cela mérite d’abord confirmation. Cela dit, il est normal, en sciences, de tout remettre en question. A la fin du XIXe siècle, on pensait tout savoir en physique. Puis sont arrivés Einstein et Planck, avec la relativité générale et la mécanique quantique… Je n’ai pas l’impression que l’on soit déjà au bout de ce qui est accessible à notre compréhension. Car nous sentons encore le flux que suivent nos réflexions.»
Dehors, sur la terrasse du port couverte de feuilles mortes, une escouade de mouettes s’envole vers la France. Loin de là, dans un havre espagnol, sommeille Cérès. Mais sur sa quille, Thierry Courvoisier imagine déjà le courant glisser: dès l’été 2012, cap sur Saint-Pétersbourg, puis la mer Blanche.
[Download not found]