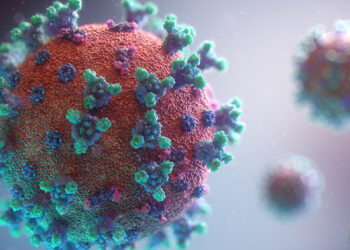Des essais de culture en plein champ d’un maïs génétique modifié ont été autorisé à Reckenholz près de Zurich, annonce ce 2 mars l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Objectifs scientifiques affichés: évaluer le comportement de la plante lorsqu’y est inséré un gène de blé induisant une résistance à des maladies fongiques. Et étudier les aspects de biosécurité liés à la dissémination des OGM.
Pourquoi c’est controversé. En Suisse, les cultures d’OGM sont interdites par un moratoire qui doit durer jusqu’à fin 2021 au moins. Mais les recherches scientifiques sont autorisées. Pour les opposants au OGM, ce nouvel essai en plein ne démontre aucune utilité, tant sur le plan agro-économique que rationnel; selon eux, son coût important ne justifie pas l’investissement et ces fonds devraient plutôt être utilisés pour développer des variétés que les agriculteurs suisses pourront cultiver en Suisse.
De quoi on parle. Le 18 décembre 2018, l’Université de Zurich a soumis à l’OFEV une demande de dissémination expérimentale de maïs modifié génétiquement dans lequel un gène de résistance du blé aux maladies fongiques a été introduit. Beat Keller, professeur au Département de biologie des plantes et microbiologie à l’Université de Zurich, qui va mener ces recherches:
«Ces études sont importantes et utiles dans le sens qu’elles nous permettent de bien évaluer les menaces parasitaires auxquelles sont soumises les cultures de maïs, et ainsi d’estimer comment on pourrait améliorer leurs résistances, et donc aussi de diminuer le recours aux pesticides.»
Les conditions. Après que 13 oppositions issue des milieux anti-OGM, de l’apiculture et de protection de la nature ont été levées – ce qui explique le temps passé depuis la demande – l’OFEV a autorisé ce matin cet essai, pour la période 2020-2023. Cela toutefois à des conditions très strictes, souligne l’office:
- L’Université de Zurich doit prendre des mesures pour éviter que du matériel génétiquement modifié soit disséminé hors de la surface d’expérimentation.
- L’institution devra préciser chaque année la taille de la surface cultivée avant chaque période de plantation.
- Afin que les abeilles ne récoltent pas de pollen génétiquement modifié, il faudra également supprimer les fleurs mâles des plants de maïs génétiquement modifiés.
Les explications de l’OFEV. Anne-Gabrielle Wüst Saucy, cheffe de la section Biotechnologie à l’OFEV:
«L’objectif scientifique – tester et évaluer l’introduction dans le maïs d’un gène de résistance du blé à des champignons – est nouveau. Cela dit, le droit ne donne pas la compétence à l’OFEV de se prononcer sur la pertinence ou le but de ces recherches, mais d’évaluer si la recherche apporte une contribution aux connaissances sur la sécurité biologique et de contrôler qu’elle soit conduite dans le respect de la protection de l’environnement de la biodiversité, la santé de l’homme et des animaux, et du libre choix des consommateurs. L’OFEV fixe des mesures de sécurité contraignantes à cet effet.»
Cet essai va peut-être raviver les discussions sur les OGM, qui ont parfois été animées ces dernières années en Suisse. Anne-Gabrielle Wüst Saucy:
«Le moratoire n’interdisant pas les disséminations dans l’environnement à des fins de recherche, la décision de l’OFEV sur cet essai n’a pas de lien direct avec les initiatives demandant une prolongation du moratoire actuel. Nous notons toutefois que suite aux dégradations répétées des essais, le Parlement a décidé en 2013 la mise à disposition d’un ‘site protégé’ pour conduire la recherche dans ce domaine. Depuis, les essais ont lieu sur ce site.»
Le site d’essai. Ces tests de culture du maïs transgéniques sont menés sur le site de l’Agroscope de Reckenholz, dans le canton de Zurich. Dans la brochure de présentation du site, on peut lire:
- Les mesures de sécurité technique comprennent notamment la pose d’une clôture autour du site, le contrôle et la surveillance permanente de la parcelle expérimentale ainsi que l’installation d’un système d’alarme.
- L’accès au site protégé est limité. Les personnes autorisées à accéder au site ont été formées aux règles de sécurité concernant la gestion des OGM.
- Sur le site protégé, différentes mesures sont prises afin d’éviter que des plantes de la parcelle expérimentale ou des semences de ces plantes ne soient déplacées et qu’elles ne soient mises en circulation ou n’entrent dans la chaîne alimentaire. Tous les échantillons de PGM capables de se multiplier qui quittent la parcelle expérimentale, comportent un emballage double et l’étiquette «génétiquement modifiés».
- Les outils et les chaussures de travail sont soigneusement nettoyés et restent si possible sur le site.
D’une superficie de 3 hectares, l’entretien et la surveillance de ce site coûte environ 750’000 francs suisses par an.
L’avis des opposants aux OGM. Ce nouvel essai est critiqué du côté des milieux anti-OGM. Luigi d’Andrea, secrétaire exécutif de l’Alliance suisse pour une agriculture sans génie génétique (StopOGM), qui avait déjà pris positivement de manière tranchée en décembre 2018:
«Nos critiques portent à plusieurs niveaux:
- Les résistances génétiquement introduites dans le maïs sont vouées à ne pas résister longtemps à l’assaut du parasite, qui s’adapte; et si le principal champignon visé venait à disparaître, un autre prendrait sa place
- Cette technologie est d’emblée inutile pour l’agriculture suisse, où le moratoire actuel sur les OGM va probablement être prolongé
- Même si on recourrait à ces nouveaux OGM, assurer une coexistence en pleine nature sans contamination avec les plants non-OGM serait impossible en Suisse, tant la fragmentation parcellaire est grande; impossible de contenir les flux de pollen.
- Les coûts de maintenance de ce site protégé sont énormes, en regard d’autres recherches agronomiques plus habituelles, sur le blé par exemple, qui doivent être abandonnées faute de fonds suffisants; cet argent pourrait être alloué ailleurs.»
Pour la politicienne vaudoise vert-libérale Isabelle Chevalley, présidente de StopOGM, cette nouvelle autorisation est «énervante et incompréhensible»:
«Pourquoi ces essais doivent-ils absolument être menés en Suisse, où la culture des OGM est interdite? Pourquoi ne pas mutualiser les résultats scientifiques obtenus dans tous les pays, notamment ceux où justement est permise la culture des OGM? De même, on n’a pas construit un CERN dans chaque pays pour y mener de manière nationale des recherches en physique des particules.
Du point de vue de la biosécurité – l’un des objectifs évoqués –, chaque OGM étant différent, les résultats obtenus avec ce maïs transgénique ne seront pas forcément largement extrapolables. C’est donc de ‘l’art pour l’art scientifique’. Je peine à comprendre cet acharnement de la part des scientifiques.»
La réponse du scientifique qui va mener ces recherches. Beat Keller:
«En Suisse en général, et à l’Université de Zurich en particulier, nous ne menons pas ce genre d’études dans un but commercial, avec en tête l’idée d’un produit final qui pourrait être utilisé dans l’agriculture suisse. Nous faisons de la recherche fondamentale, pour avoir une meilleure compréhension de la nature.»
Concernant la question de mener ces essais à l’étranger?
«C’est intéressant, je ne l’avais jamais entendue. Mais premièrement, il paraîtrait stratégiquement étrange qu’on commence ces études en Suisse pour les achever à l’étranger. Qui plus est en y faisant la partie la plus controversée; on nous reprocherait rapidement de ne pas assumer jusqu’au bout notre démarche. Enfin, les conditions environnementales et les menaces parasitaires ne sont pas identiques partout sur la planète.»
Enfin, concernant les coûts élevés:
«Il s’agit de rappeler que 90% des 750’000 CHF sont alloués à des frais de surveillance, qui pourraient être évités si ces recherches se déroulaient dans des conditions totalement sereines, sans menace d’être réduites à néant.»
Les autres enjeux de cet essai. Les études sur les OGM ne sont plus nouvelles. Mais le débat public, lui, ne cesse de revenir sur le devant de la scène, notamment sur les plans éthiques voire presque socio-philosophiques.
Luigi D’Andrea:
«Cela fait-il notamment sens de vouloir mélanger diverses espèces biologiques pour tenter d’améliorer la nature, alors que celle-ci procède depuis des milliers d’années à des hybridations en fonction des changements dans l’environnement? Le génie génétique répond aux besoins de l’agriculture industrielle, alors que nous allons de plus en plus vers un nouveau paradigme faisant une plus grande place à l’agroécologie, pour laquelle les OGM ne sont pas vraiment nécessaires.»
Anne-Gabrielle Wüst Saucy:
«En effet, ces questions se posent au sein de la population et des milieux politiques. Et elles le sont à chaque fois que l’on parle d’un nouvel essai en plein champ. A nouveau, l’OFEV traite les demandes uniquement à l’aune du droit actuel, et n’a pas à se prononcer à d’autres niveaux de discussion.»
Le contexte historique. En 2005, le moratoire pour une agriculture sans OGM était accepté en Suisse après une votation populaire. Peu après, un vaste Programme national de recherches (PNR59) sur les OGM et les effets sur l’environnement a été lancé, la recherche scientifique en plein champ ayant été explicitement exclue de ce moratoire.
Entre 2008 et 2010, des essais en plein air ont été menés sur une parcelle de Pully, mais le site a été saccagé par les opposants aux OGM, ce qui a conduit à l’arrêt de ces essais. En 2011, le PNR59 concluait à l’absence d’effets négatifs des OGM pour l’environnement. Mais une nouvelle étude menée en 2012 à l’ETH de Zurich a observé qu’une espèce de blé modifié pouvait avoir des effets nuisibles non seulement sur les parasites visés, mais aussi sur les coccinelles qui les consomment.
Le moratoire a été prolongé à plusieurs reprises, le délai actuel étant fixé à fin 2021. Mais une nouvelle demande de prolongation de 4 ans a déjà été déposée fin septembre 2019 devant le Conseil national par l’UDC bernois Andreas Aebi, convaincu que le public n’est pas prêt à acheter et consommer des OGM cultivés en Suisse.