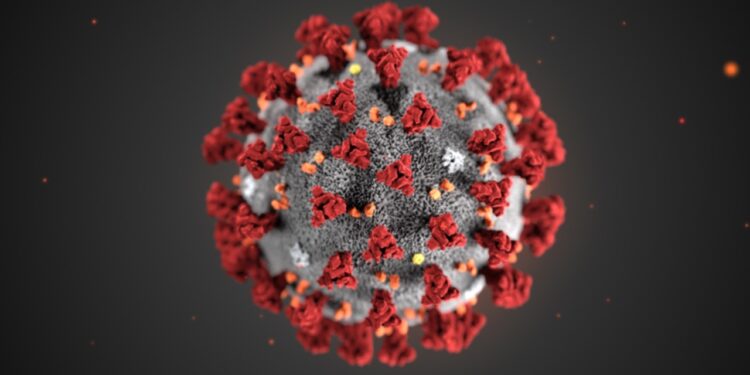Une personne infectée par le nouveau coronavirus 2019-nCoV qui ne présente encore aucun symptôme peut-elle malgré tout transmettre le microbe à d’autres? C’est l’une des questions qui taraudent le plus les infectiologues aujourd’hui. Un article paru jeudi dernier dans le New England Journal of Medicine (NEJM) le laissait penser. Mais il s’avérerait que, écrit et publié dans une trop grande précipitation, il contiendrait des erreurs.
Pourquoi c’est crucial. Si ces conditions particulières de propagation du virus étaient avérées, elles rendraient beaucoup plus difficiles les actions visant à contenir l’extension de l’épidémie: il serait en effet quasi impossible de protéger, voire de maintenir en quarantaine, les porteurs du 2019-nCoV, qui seraient par définition très difficiles à identifier. Normalement, ces virus se transmettent surtout dès l’apparition des symptômes. Dans le monde des virus provoquant des infections respiratoires, cette situation serait inédite.
De quoi on parle. Il y a plus d’une dizaine de jours, le ministre chinois de la santé Ma Xiaowei a évoqué en conférence de presse la possibilité d’une transmission dite «asymptomatique» du virus, avec pour origine des individus ne présentant donc aucun des symptômes observés jusque-là: maux de tête et de gorge, état fébrile, douleurs musculaires, toux persistante, congestion nasale… Mais les chercheurs chinois n’ont pu présenter des preuves indiscutables de leurs observations.
Le 30 janvier 2020, des chercheurs allemands publient à leur tour, dans le renommé NEJM, la description de ce qui semble être un tel premier cas de transmission asymptomatique. Une femme d’affaires en provenance de Chine, en séjour près de Munich, en Allemagne, aurait contaminé quatre de ses collègues de travail (deux directement, et deux autres à travers ces deux premiers) alors que ses symptômes à elle ne seraient déclarés qu’après cette rencontre, dans son avion du retour en Chine.
Les réactions des experts. Ces recherches ont fait prendre la parole à Anthony Fauci, directeur du National Institute for Allergy and Infectious Diseases américain, un personnage officiel très connu et respecté aux Etats-Unis:
«Il n’y a aucun doute, en lisant cet article, que des transmissions asymptomatiques ont lieu. Cette étude clôt la question.»
Plusieurs virologues se sont montrés plus réservés, voire surpris. Dont Didier Trono, professeur au laboratoire de virologie et génétique de l’EPFL, interrogé lundi par Heidi.news:
«La description de ce cas n’est pas absolument claire, les scientifiques affirmant que la femme chinoise a vu apparaître ses symptômes juste après sa rencontre avec ses collègues allemands. Il se peut qu’elle en ait déjà eu de légers juste avant, et fût déjà contagieuse lors de ce meeting.»
Le coup de théâtre. Lundi, des représentants du Robert Koch Institute (RKI), l’agence de santé publique allemande, ont écrit au NEJM pour rectifier l’histoire, raconte lundi soir le site de Science: les auteurs de l’article original n’avaient en réalité jamais parlé directement avec la femme chinoise soupçonnée d’avoir transmis le virus de façon asymptomatique à ses quatre collègues avant de soumettre leur étude à publication. Le RKI, notamment, a repris contact avec cette femme, et il s’est avéré qu’elle avait bel et bien plusieurs des premiers symptômes (fatigue, douleurs musculaires) alors qu’elle se trouvait encore en Allemagne, et qu’elle aurait même pris des médicaments contre la fièvre (paracetamol).
L’explication. Le professeur Didier Trono évoquait déjà des doutes, avant que soit révélée cette malfaçon:
«Lorsqu’un tel virus pénètre dans votre corps, il se multiplie rapidement, engendrant une réaction violente du corps. Cette phase pendant laquelle les futurs malades peuvent encore se demander ce qui leur arrive peut durer un à deux jours. Mais à ces moments-là déjà, on voit apparaître les premiers signes de la maladie. Et l’on est contagieux. C’est comme pour le virus de rhume: on peut le transmettre bien avant d’avoir une obstruction massive des fosses nasales au point de vous en faire fermer les yeux.»
Selon Isaac Bogoch, spécialiste en maladies infectieuses à l’Université de Toronto, interrogé par Science, les chercheurs auraient dû être plus explicites:
«Asymptomatique signifie qu’il n’y a aucun symptôme. Zéro. Cela signifie que vous allez parfaitement bien.» Ce qui, précise-t-il, n’était pas le cas ici, où des symptômes non spécifiques ont a posteriori été relevés. «Nous devons faire attention avec nos mots.»
Que conclure. Sur le plan médical:
- Exclure la possibilité de la transmission asymptomatique est encore, malgré tout, prématuré. Anthony Fauci explique être en contact avec ses collègues chinois, qui lui disent être convaincus qu’une telle transmission a eu lieu. L’épidémie est encore trop récente pour que cette question soit tranchée, dans un sens ou dans l’autre.
- Pour se répandre, le virus 2019-nCoV a besoin d’un vecteur de transmission. En l’occurrence, explique Didier Trono, il s’agit d’excrétions de la bouche ou du nez, qui peuvent être aéroportées (dans des espaces clos par exemple), mais surtout propagées par le toucher, après s’être retrouvées sur les mains de la personne malade. Or les personnes totalement asymptomatiques toussent, crachent reniflent, et se mouchent beaucoup moins. L’OMS elle-même a indiqué que, même si transmission asymptomatique il existe, ce mode de propagation ne pouvait jouer qu’un rôle mineur dans l’épidémie. La littérature scientifique sur la grippe montre par ailleurs qu’il existe une corrélation nette entre présence importante de symptômes et transmission du virus. Ainsi, ce sont avant tout les personnes symptomatiques qu’il faut repérer rapidement afin de les empêcher de contaminer les autres (les mettre en quarantaine, leur faire porter des masques, etc.).
- Les patients qui présentent des symptômes légers pourraient être très nombreux. C’est le cas des quatre personnes décrites dans l’étude initiale du NEJM, qui présentaient des signes légers de la maladie. C’est aussi ce qui fait dire à Didier Trono que d’une part, de très nombreuses personnes contaminées passent actuellement «sous le radar», d’autre part le virus n’est probablement pas si létal:
«Le rapport entre le nombre de cas de contamination effectivement recensés et le nombre de décès liés au 2019-nCoV de manière avérée, ne cesse en effet de diminuer – il est à environ 2% aujourd’hui.»
Et l’expert, qui se veut rassurant, de rappeler, comme avec la grippe saisonnière (qui fait environ 650’000 morts chaque année), que ce sont avant les personnes déjà fragilisées (personnes âgées, nourrissons, femmes enceintes, personnes ayant déjà d’autres affections) qui sont les plus à risque. «L’épidémie aurait pris d’autres proportions si le risque de transmission asymptomatique était très grand.»
Selon lui, plus d’informations seront disponibles lorsque l’on aura les tests sérologiques des personnes ne s’étant pas senties bien ces derniers temps. Or pour cela, il faut d’abord que ces individus développent des anticorps face au virus, ce qui prend entre deux et six semaines. Actuellement, le diagnostic du 2019-nCoV se fait par des méthodes génétiques (test PCR), qui nécessitent, pour être fiables, une quantité suffisante de matériel viral. Didier Trono ajoute:
«Ce qui laisse supposer qu’un grand nombre de personnes malgré tout infectées n’a pas été testé», l’immense majorité étant encore en vie.
Un problème connexe. Au final, le cas allemand en dit aussi beaucoup sur un autre enjeu, celui de la difficulté à disposer, en temps d’urgence de santé publique, de données de recherche fiables. Christian Drosten, de l’Hôpital universitaire Charité de Berlin, et co-auteur de l’étude allemande dans le NEJM, répondant au journaliste de Science:
«Je me sens mal concernant la manière dont tout cela s’est passé, mais je ne pense pas que quiconque soit en faute ici. Apparemment, la femme [chinoise] ne pouvait pas être jointe immédiatement [pour lui demander si elle avait des symptômes], et il a été estimé que l’on devait communiquer rapidement sur ce cas. »
Marc Lipsitch, épidemiologiste à la Harvard T.H. Chan School of Public Health, interrogé par le magazine, mais qui n’a pas participé à l’étude, souligne aussi la difficulté:
«Je pense que le processus du peer review [révision et validation par les pairs des études soumises à publication] est plus léger au milieu d’une épidémie qu’en temps normal, et aussi que la qualité des données servant à produire ces études est nécessairement plus incertaine.»
De quoi non pas jeter le bébé avec l’eau du bain, mais prendre le temps, sans panique, de bien évaluer les faits et chiffres à disposition.